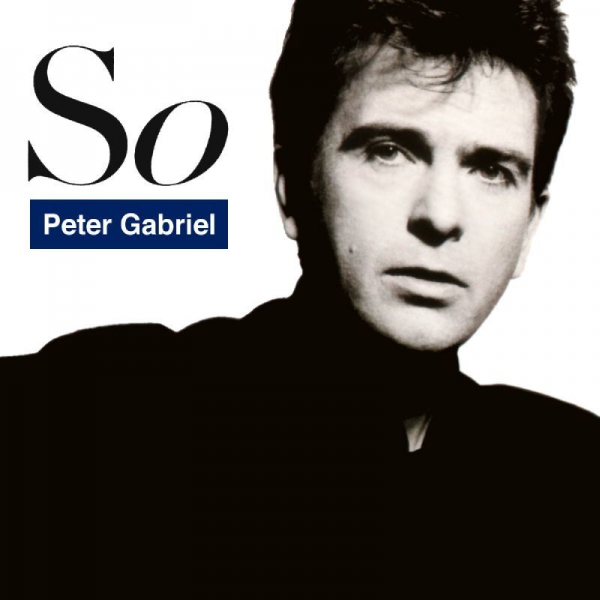Steven Wilson
The Future Bites
Produit par Steven Wilson, David Kosten
1- UNSELF / 2- SELF / 3- KING GHOST / 4- 12 THINGS I FORGOT / 5- EMINENT SLEAZE / 6- MAN OF THE PEOPLE / 7- PERSONAL SHOPPER / 8- FOLLOWER


Les années, que dis-je, les décennies passent, et au fil du temps, on ne peut que s’enthousiasmer de la place que prend Steven Wilson dans le paysage musical contemporain tellement l’homme le mérite eut égard à son époustouflante production discographique, tant qualitative que quantitative. Concernant ce second item, si beaucoup pourraient commettre l’erreur (grossière) de considérer The Future Bites comme le sixième album de l’Anglais, le connaisseur aura tôt fait de rectifier le tir : sixième album sorti sous son nom propre. De notre côté, on a fait le compte : nous avons ici affaire au cinquante-cinquième album de SW en comptant ses productions avec Porcupine Tree (dont beaucoup sont d’authentiques travaux solo), IEM (idem), Bass Communion (idem) ou encore Altamont (avec Simon "Si" Vockings), God (avec Richard "Ford" Leggott), Continuum (avec Dirk Serries), Blackfield (avec Aviv Geffen), No-Man (avec Tim Bowness) et Storm Corrosion (avec Mikael Åkerfeldt). Cinquante-cinq albums ! Et on ne compte pas les EP, singles, recueils de B-sides et autres travaux de production - (re)masterisation. Respect, mec, vraiment. Pour autant, on ne va pas se mentir : au bout d’un moment, le robinet créatif finit invariablement par se tarir, or il semble que Wilson vienne ici d’atteindre ses limites.
À ce stade, une analyse des récentes interviews du natif d’Hemel Hempstead s’avère nécessaire, car en substance Wilson y avoue beaucoup de choses. Son récent mariage - lui qui pensait ne jamais être capable de fonder une famille - l’a conduit à mettre la bride à sa productivité frénétique et à sa présence sur scène, et on le comprend tout à fait. Désormais beau-père de deux pré-adolesentes, Wilson semble avoir accepté, à leur contact, l’idée que l’album en tant qu’objet musical avait fait son temps et que l’ère des singles s’était irrémédiablement ouverte ; plus encore, que l’ère du rock était arrivée à son terme au profit de la pop, presque une excuse pour s’ébaubir devant l’album phénomène d’une certaine Billie Eilish (il est vrai excellent, reconnaissons-le) qui semble l’avoir visiblement traumatisé tant artistiquement que techniquement (n’oublions pas que SW est avant tout un ingénieur du son, c’est sa profession initiale). Là-dessus, le voilà qui, comme un certain Alex Turner, s’avoue désormais strictement incapable de composer à la guitare et de facto contraint - par choix et par goût autant que faute de mieux - de se rabattre sur le piano et les outils électroniques. Arrive enfin le passage obligé de l’artiste qui, connaissant enfin le mass success qui lui avait toujours échappé depuis trente ans, en profite - et qui le blâmerait - pour jouir d’une liberté artistique, technologique et financière quasi totale, suivant en cela la trajectoire d’un Peter Gabriel ou d’un Bruce Springsteen (toutes proportions gardées, bien sûr). Voilà jetées les bases de The Future Bites, et à l’arrivée, on ne peut pas franchement s’étonner d’avoir affaire à un demi-succès tant la donne a profondément changée pour l’intéressé.
The Future Bites entérine la mue pop opérée sur To The Bones, mais il convient également de remettre ici les points sur les i. Que les abrutis qui agonisent Wilson d’injures face à cette évolution commencent déjà par réécouter - oui oui - les premiers émoluments du binoclard, le maladroit On the Sunday Of Life, le bouillonnant Voyage 34 (tient, on ne l’a pas compté dans les cinquante-cinq, lui) ou encore l’ultra-référencé The Sky Moves Sideways, en saupoudrant le tout de quelques passages de Lightbulb Sun et les reprises de Cover Version : ce LP 6 sorti sous le patronyme de Steven Wilson ne fait que revenir à certains sons et tournures affectionnés dans sa jeunesse, cette sacro-sainte équation Donna Summer - Pink Floyd. L’orientation en elle-même n’est pas spécialement à blâmer, non plus qu’elle apparaît étonnante, mais elle s’accompagne cette fois-ci d’un déficit de fond. Si jusqu’ici Wilson avait su conserver un équilibre entre pièces pop directes contenues - on va dire FM compatibles - et longs morceaux tout à la fois complexes et roboratifs, on constate ici une carence dans la seconde catégorie, ce qui en soit ne serait pas vraiment préjudiciable si la première excellait, mais c’est loin d’être le cas.
The Future Bites souffre d’une entame poussive, et c’est un euphémisme. Si l’on conçoit que “Self” en lui-même ne saurait constituer un morceau introductif - trop direct, trop monolithique -, on comprend la nécessité d’ajouter un court titre à ce dernier, en l’occurrence “Unself”, mais celui-ci étonne par sa vacuité intrinsèque, sans compter qu’il s’enchaîne très mal avec son pendant. “Self”, parlons-en, constitue certainement l’une des compositions les plus faibles de Wilson : noire et glacée, sa progression mélodique se montre pauvre et peu susceptible de nous toucher, sans même parler d’un refrain bâclé. Formellement, c’est très bien réalisé, et l’on touche là à un grief redondant sur ce disque-ci : l’emballage se supplée au cadeau qu’il enveloppe. The Future Bites se pose un peu trop comme un disque de producteur, ce qui est paradoxal quand on sait que Wilson, pour la première fois de sa vie ou presque, a fait appel à une aide extérieure à ce poste - en l’occurrence David Kosten (certes, Alan Parsons lui a prêté main-forte à quelques reprises, dont acte). Beaucoup de soin, plus encore que d’habitude, a été apporté à la prise de son, au mixage, à l’emploi savamment étudié d’éléments à la fois acoustiques et électroniques. Quoique décentrée, la guitare prend une place particulière dans cet album : elle se détache du riffs et sert à orner chaque pièce à la marge, quelques saillies déstructurées par-ci, un solo dissonant par-là (“Self”, “Eminent Sleaze”), simple élément décoratif parmi tant d’autres. Gros travail également sur la voix, même si on peut regretter l’emploi un peu trop systématique de chœurs féminins soul et que certains préféreront le Wilson d’avant, certes moins affirmé mais justement sans doute plus pudique et touchant. D’autant que cette perfection formelle ne se met pas au service de morceaux inattaquables, et dès lors, les tours de platine successifs ont tôt fait de révéler une certaine lassitude. Que retenir, par exemple, de “King Ghost” hormis ces merveilleux arpèges ascensionnels ? Le problème, c’est que quand on creuse, on constate qu’il n’y a pas ou peu de mélodie ici, avec un refrain là encore réduit à sa portion congrue et qui finit par agacer par son emploi d’un vocoder dérangeant. Dès lors, difficile de remonter la barre, quand bien même le reste se révélerait à la hauteur… ce qui est plus ou moins le cas.
Reste qu’avec neuf titres et quarante-deux minutes au compteur, The Future Bites pêche également par une brièveté tout à fait inhabituelle chez Steven Wilson. Réglons également son compte à “Eminent Sleaze”, articulé autour d’un motif funk-blues atypique pour l’Anglais et là encore pas spécialement mémorable : trop d’homogénéité nuisent à un titre certes balancé mais un poil irritant à force d’écoutes. Fort heureusement, on va pouvoir arrêter là les griefs et s’attarder sur le positif de l’album, car il y en a. La thématique, tout d’abord, avec un disque qui aborde assez finement divers travers et carences du monde moderne, autocentrisme éhonté (“Self”), consommation flattant l’égo (“Personal Shopper”), exploitation sans gêne des faibles (“Eminent Sleaze”). Cette noirceur, souvent commune aux disques de Wilson, sait se montrer accessible et finalement abordée avec un certain détachement voire un certain humour quand la charge émotionnelle s’avérait parfois suffocante sur ses précédents livraisons, on pensera notamment à Fear of a Blank Planet ou Hand.Cannot.Erase. Et puis on note tout de même d’excellents morceaux au premier rang desquels “Twelve Things I Forgot”, authentiquement lumineux quand l’homme aimait jadis à se (com)plaire dans le clair-obscur, petit bijou de composition, d’interprétation et d’arrangements (avec même quelques petites touches rappelant “The Great Gig In The Sky” dans les choeurs) ; ou “Man Of The People”, lui aussi saisissant dans sa maîtrise des palettes émotives, entre glace superficielle et tiédeur céleste, quelques traversées synthétiques renvoyant directement, encore (!), à Pink Floyd - “Welcome To The Machine”, pour ne pas le citer. Ces couleurs floydiennes s’avèrent suffisamment digérées pour faire sourire, d’autant que l’homme est un coutumier du fait - certes moins sur ses plus récentes livraisons. Et puis on adhère sans partage à “Personal Shopper”, pièce wilsonienne dans toute sa splendeur, avec ce rush sombre servi par une électronique vénéneuse et rehaussée par une merveille de refrain harmonisé. Pour l’anecdote, c’est Elton John qui énumère les divers produits de consommation personnalisés qui sont ici fustigés au gré d’un intermède certes un peu longuet. On aime aussi sans trop de réserve “Follower” - référence explicite à Twitter, nerveux, haletant et là encore suffisamment mélodieux pour fédérer. Dès lors on passera sur un “Count Of Unease” pas déplaisant mais pas réellement taillé pour demeurer dans les annales.
Il n’empêche qu’au final, The Future Bites marque le pas, ô combien, au sein de l’éclatante discographie du sieur Steven Wilson. Ceux qui connaissent mal l’artiste se repaîtront avec plaisir de cette ultime livraison quand les aficionados auront bien du mal à lui trouver beaucoup d’intérêt, préférant dès lors se repasser moult grands disques du maître du progressif moderne, Hand.Cannot.Erase, The Raven That Refused To Sing, Fear Of A Blank Planet ou In Absentia - album qui fête ses vingts ans cette année, avec à la clé une réédition bourrée de B-Sides qu’on vous conjure de considérer avec autant d’avidité qu’il se doit. Ou même Blackfield I et II, ou même Voyage 34, pour rester dans la tonalité de ce bien décevant opus. D’ailleurs il paraît que Wilson veut interpréter sur scène son trip halluciné de 34 minutes en live, une première à laquelle on se réjouit d’assister en live, c’est déjà ça. A quand la réouverture des salles de concert ?