
Discorama 2000's : les incontournables hard rock/metal
- Introduction
- 2000-2001
- 2002-2004
- 2005-2006
- 2007-2009
2002-2004
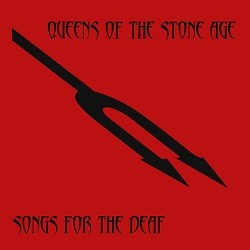
août 2002
Un moteur qui démarre, une porte qui claque et une radio qu’on allume. Ainsi commence Songs for the Deaf. L’invitation parfaite à un road trip sonore sans précédent à travers le désert des Mojaves. La radio est branchée sur "Klone radio", station imaginaire au gingle profondément ironique ("The songs that sound more like anyone else, than anyone else") où un énigmatique animateur se chargera de donner le départ de la charge sonore à venir. Et dans la caisse, est embarqué un sacré beau monde. Josh Homme, au volant du bolide, s’est entouré une fois de plus avec goût. Dave Grohl délaisse un instant ses Foo fighters pour venir s’installer derrière les fûts, et l’hystérique Nick Oliveri rempile à la basse. Véritable moteur du groupe, le duo Grohl/Oliveri fait preuve ici d’une efficacité sans pareille et constitue sans doute l’une des sections rythmiques les plus détonantes de la décennie…
Peut alors commencer un voyage composé de riffs robotiques et tranchants gavés d’effets fuzz, de mélodies pop torturées et déstructurées à loisir, d’énergie punk et de hard rock psychotique. D’entrée, l'excellent "You Think I Ain't Worth a Dollar, But I Feel Like a Millionaire" frappe (très) fort. Le jeu de baguettes de Grohl, plus précis qu’un métronome et plus acéré qu’un rasoir Gilette mach 3 turbo, plante le décor et prépare l’entrée d’un riff détonnant de Homme et du chant ( hurlement ?) de Nick Oliveri. Une décharge sonore balancée plein pot à la tête de celui qui aura eu la bonne idée d’insérer la galette dans sa chaine. Une introduction réussie en somme. Les pépites s’enchainent ensuite comme pour maintenir un rythme effréné. Pas question de ralentir. "No one knows", "First it giveth" ou "Go with the flow", entrecoupées d’interludes radio, font preuve d’une attention réelle portée à la mélodie, tout en prenant le soin de faire péter le tout à coups de breaks soudains ("You Think I Ain’t…") ou de changements de rythmes incessants ("Songs for the dead"), marques de fabrique de ce Songs for the deaf. En chemin, le groupe embarque Mark Lanegan, crooner rescapé des Screaming trees, le temps de quelques morceaux qui figurent pour certains parmi les meilleurs de l’album. (Une écoute du fantastique "God is in the radio" suffira pour s’en convaincre). Si les qualités de cet album sont nombreuses, la surprenante alchimie qui règne entre les différents membres du groupe s’impose néanmoins comme l’une des clés principales de sa réussite, tant les individualités semblent s’y mêler avec fluidité. Le sens de la mélodie et les riffs acérés de Homme, la frappe dantesque de Grohl, le penchant punk d’Oliveri et la voix gutturale de Lanegan se fondent dans un ensemble sonore étonnamment cohérent, qui parvient pourtant à surprendre d’un bout à l’autre du disque, qui ne souffre d’aucune baisse de rythme.
Josh Homme, laborantin du rock de ses débuts dans Kyuss au récent Era vulgaris, dernier album en date des QOTSA (et à travers ses nombreux projets dont les expérimentales Desert Sessions), a toujours su se libérer avec ingéniosité des limites de chacun des genres qu’il a abordé. Les deux premiers albums du groupe avaient déjà esquissé les contours d’un univers sonore unique, entre hard rock, pop et psychédélisme. Après Queens of the stone age et Rated R, il ne manquait qu’un album de plus pour fondre le tout dans un bloc homogène. Parfaitement maîtrisé, jonglant entre hard rock énervé et pop planante sans pour autant se perdre dans le processus, Songs for the deaf remplit cette mission. Et en passant, se classe directement parmi les albums les plus marquants de la décennie, tous genres confondus. Belle performance.
Thomas
lire la chronique de l'album

septembre 2003
Oceansize est entré dans cette décennie en présentant tous les attributs d’une musique aussi particulière que sensible. Entre pure métal et post-rock atmosphérique, à la manière de Tool ou Perfect Circle, on ne se lasse pas de découvrir leur univers tortueux à travers Effloresce, premier jet particulièrement réussi d’une suite de trois albums qui couvriront les dix premières années 2000.
Effloresce jette ainsi les bases d’un métal caractéristique du groupe. Mais si les cinq mancuniens ne cachent pas leurs inspirations du côté des formations de Maynard James Keenan, ils ont su davantage apporter en intégrant ici et là les éléments d’une complexité décomplexée, rendant au métal sa douceur qu’on ne lui prête que peu. Et ça passe par des nappes électroniques semblables à ce qu’on pourrait trouver sur un disque de Sigur Ros, ou par des arpèges de guitares lancinants, que le groupe sublime ici avec la batterie lourde et les riffs caractéristiques du métal. C’est "I am the morning" qui ouvre ainsi la marche toute en longueur, séduisant dès les premières notes les oreilles les plus réticentes aux sons du métal. Pour les aficionados de plus de violence, en revanche, pas d’inquiétude, puisque Oceansize effectue facilement le grand écart d’une musique à l’autre sachant plaire dans des styles aussi différents que le métal ("Amputee") ou le trip-hop ("Unravel"). Parfois à l’intérieur même du morceau, l’accalmie se fait sentir, comme le groupe sait le montrer dans les 10 minutes assommantes de "Massive Bereavement". Une maîtrise des compositions torturées qui fait la force d’Oceansize. C’est ainsi assez rarement que la voix du leader Mike Vennart vient ponctuer avec brio les séquences musicales de ses multiples tonalités, pour donner un côté pop-rock aux cascades de sons, tentant quelques fois le hurlement caractéristique du métal ("You Wish").
Mais qu’on ne s’y trompe pas, l’accessibilité d’Effloresce a de quoi déplaire au public propre de chacun des genres parcourus dans cet album. Les fans de métal seront déçus, les fans de down-tempo aussi. C’est pourtant cette richesse d’une complexité intelligente qui donnera à Oceansize la place qu’il mérite parmi des productions déjà cultes d’une décennie innovante pour le métal.
Geoffrey

septembre 2003
A l'aube de l'année 2000 le charismatique et génial Maynard James Keenan est désespérément en manque de création avec Tool, il est à l'époque en conflit avec sa maison de disque. Sous l'impulsion de Billy Howerdel, A Perfect Circle voit donc le jour et rencontre un succès immédiat avec son premier album : Mer de Noms. Trois ans plus tard, Maynard et son compère remettent le couvert avec leurs complices : le guitariste Troy Van Leeuwen et le batteur Josh Freese sont toujours présent pour l'enregistrement de Thirteenth Step ; seul Jeordie White (alias Twiggy Ramirez), ancien bassiste de Marylin Manson, supplée la craquante Paz Lenchantin (cf le clip "Judith" réalisé par David Fincher).
Si Mer de Noms a été créé dans l'immédiateté et a une résonance metal, Thiteenth Step recouvre un univers plus mélodique et mélancolique. Plus toolien en quelque sorte, même s'il est plus abordable et moins expérimental que la bande originelle de MJK. La patte du maître d'oeuvre y est prégnante alors que sa voix, si singulière et éloignée des standards du metal, n'a jamais été aussi bien possédée. En force ou en douceur, il hausse le ton ou susurre au gré des allures en nous embarquant dans les méandres de ce monde (d)étonnant parsemé de multiples sens. Emmenées par une puissante et séduisante rythmique, les guitares sont à la fois légères et brutales. Des cordes et des choeurs les accompagnent. Cette atmosphère éthérée est contrebalancée par l'intensité qui se dégage de Thirteenth Step, dont l'écoute s'avère être une expérience rare. Rien de plus logique à cela puisqu'il traite selon Maynard de l'addiction sous toutes ses formes. Saisi par l'ouverture de "The Package", plongé dans l'introspection le temps des cinq morceaux suivants, dont la sublime montée en puissance de "The Noose", l'hypnose sensorielle fait son effet. La violence redevenue métal de "The Outsider" et de "Pet" a beau encadrer une chanson étonnamment pop ("The Nurse who loved me"), A Perfect Circle nous ne nous laisse aucune échappatoire : "go back to sleep, go back to sleep..."
En ballade mentale, traversé et même envahi par les sentiments de tout être vivant et intelligent, Thirteenth Step ne cesse d'envoûter pour nous transporter dans un monde presque parfait dont on a du mal à sortir. Afin de se nourrir de sa quintessence, son écoute régulière devient irrépressible. Même encore aujourd'hui vous avez des chances de replonger. Depuis Emotive, leur troisième et dernier album à ce jour (fait essentiellement de reprises inattendues), les annonces plus ou moins régulières d'un nouvel opus restent sans suite. Hélas ! Car si le vicieux MJK, engagé actuellement dans son autre side-project Puscifer, avait le bonheur de lâcher également la grappe de ses vignes pour reformer ce cercle avec Billy Howerdel, il ferait à coup sûr quelques bienheureux. En attendant ce jour, qui sait, libre à vous de prendre votre pied avec cet incontournable album culte de la décennie passée.
Marc
lire la chronique de l'album

mars 2004
A travers le monde, il n’y a peut-être que 10 000 fans de Clutch. Mais ils suivront le groupe jusqu’à leur mort, contrairement aux millions de mal-embouchés qui se précipitent sur le dernier U2 qu’ils n’écouteront plus dans quelques mois. Clutch est sans doute le secret le mieux gardé de la scène indépendante américaine, né dans le Maryland profond, berceau de la scène doom (The Obsessed, Saint Vitus…), là où les effigies vaudous croisent les marais douteux et les rednecks en santiags crottées. Contemporains de Kyuss, partageant avec le combo de Palm Desert le même amour de Black Flag, le quartet est un véritable cas à part, se mouvant dans une espèce de no man’s land. Jouissant d’une véritable aura culte, sans jamais arriver à être récupérés par le système (quelques majors les ont signés pour une poignée de disques, sans succès), les Clutch tracent leur route solitaire sans faire la moindre concession, avec un zèle effréné. L’industrie du disque peut s’écrouler, le fan sait que chaque année il y aura un nouveau Clutch, que ce soit un album, un live, ou une compilation d’inédits.
Comment expliquer une telle situation, si isolée ? Il faut dire que la musique de Clutch est impossible à ranger derrière une étiquette précise, même si en la matière on emploie souvent le terme stoner. C’est que leur rock, aussi âpre que girond, ces vétérans le taillent sous différents angles avec une voracité monstre depuis des années, sans avoir de maître à penser direct, et sans engendrer de descendance claire. Leur discographie, riche de neuf opus studio et d’une foultitude de réalisations apocryphes, aligne une impeccable progression, paradoxalement fluide, partant d’un hardcore revêche, puis prenant de plus en plus les contours d’un heavy funk particulièrement obèse et percutant pour se fondre enfin, à l’orée de Robot Hive/Exodus, vers un blues définitivement heavy, mais finaud. Dopé par une section rythmique de premier choix (le bassiste Dan Maines et le batteur Jean-Paul Gaster, imposant cogneur autant féru de jazz que de hip-hop et de rock plombé) déversant une espèce de lave épaisse aussi massive que souple, ainsi qu’une fine lame bourrue en guise de guitariste (Tim Sult), le combo se distingue également par son fantasque frontman : Neil Fallon, chanteur comme on en fait peu, éructant, prêchant, fanfaronnant de sa voix chaude sur ce tapis bouillonnant des textes aussi burlesques qu’obscurs que les fans se complaisent à décortiquer dans leurs moindres méandres. C’est ce brassage multiple d’influences qui fait de Clutch une bête tout à fait à part, à la voix rustre de par le rock de Titan courroucé qu’elle besogne, et disposant en même temps d’un univers riche, dense, où se mêlent références historiques, littéraires et mythologiques.
Ce savant mélange de rugosité et de subtilité est amplement illustré par cette sixième réalisation studio, qui pousse l’alchimie de son prédécesseur (Pure Rock Fury) encore plus loin dans l’excellence. Au pinacle de sa puissance, le quartet impose une alternance jubilatoire entre groove obsédant semblant issu d’une jam illicite entre Cypress Hill et le J Geils Band ("Profits of Doom", "Cypress Groove", "Worm Drink"), heavy blues affuté ("The Regulator", "Ghost") et les rugissements rauques d’un hard revêche ("Army Of Bono", "Spleen Merchant"). Généreux (15 titres), le disque ne perd pas une seule seconde sa faconde, pilonnant de riffs en breaks sa hargne bourrue, boueuse et enfumée. Nul doute que les Clutch ont définitivement assis leur règne dans l’une des galeries de l’underground US à la force de cet opus remarquable, qui reste l’un des sommets d’une discographie himalayesque.
Maxime

juin 2004
Lemmy Kilmister. Un nom. Une gueule. Et une sacrée attitude basse Rickenbacker en main. Et Motörhead ? 35 années de bons et loyaux services au nom de sa majesté le rock'n'roll, tout de même, ça compte. Ou du hard rock ? Clairement, on s'en foutra comme de l'an 40 car Lemmy et sa bande ont pulvérisé depuis longtemps toutes les limites du genre à coups de riffs de basse propulsés au V8. Traçant comme un gang de hell’s angels lancé à toute blinde sur la 66, le groupe balance depuis plus de trente ans ses disques comme autant de brulots à décibels, cocktails Molotov sonores sans concessions.
Car comme Attila le Hun avant lui, Lemmy ne reculera que face à la mort et cela, tout fan de la "bande à Lemmy", le sait. Nombreux sont ceux qui ont grandi au son d’Ace of Spades ou Bomber sur leur walkman pourri, rêvant d’asphalte et de rock and roll dans une chambre d’ado aux murs tapissés de posters d’Iron maiden, Metallica et évidemment Motörhead. Et avec Inferno, sorti en 2004, sieur Kilmister (à près de soixante berges passées et accompagné des désormais fidèles Phil Campbell et Mikkey Dee), délivre comme à son habitude une bonne dose de décibels à même de contenter les fans avides de rock’n’roll burné.
A la lecture de la liste des morceaux de l’album, le fan assidu aura d’ailleurs tôt fait de se rassurer: "Smiling like the killer", "Life's a bitch" ou "Suicide". Lemmy ne l'a pas floué, c'est certain. L'homme à qui l'on doit "The Ace of spades" et "Killed by death" (littéralement "Tué par la mort", il fallait oser), déçoit rarement, et il est bon de le rappeler. Insérant la galette de ses mains tremblantes dans son installation sonore, l’auditeur averti commencera, malin, par monter le son, mention spéciale pour les basses. Car on le sait, Lemmy et sa bande envoient du bois d'entrée. Les premières notes de "Terminal show", soutenues par une batterie littéralement épileptique en prélude au chant de rocailleux du maître, confirme nos espérances les plus folles. Motörhead n'a pas changé. Il convient d'ailleurs de préciser que Motörhead fait partie de ces groupes qui ne font pas dans l'évolution stylistique, ou plus généralement, dans le changement. Pas d'autre objectif que de multiplier les riffs dévastateurs. Et la mission, une fois n'est pas coutume, est ici remplie dans les règles de l'art. "Killers", "In the name of tragedy" ou "Suicide" suivent une même et unique ligne directrice. Jouer vite, fort, et si possible des riffs qui envoient. Et sans oublier si possible le sacrosaint solo de guitare, disparu depuis trop longtemps des ondes FM.
Après 11 titres passés à "headbanger" comme un malade, cramponné au meuble qui soutient la chaine hifi, épuisé par les décibels crachés par les hauts parleurs sur "Smiling like the killer", on attend le morceau final comme un ultime adversaire, prêt à en découdre une dernière fois. La voix de la bête, étrangement claire, ("pourtant le son est à fond", se dira alors le fan incrédule) lance calmement : "one, two, three, four". C’est là que retentit contre toute attente… une guitare acoustique. L’incompréhension la plus totale s’installe. Un regard sur la pochette de l'album donnera une réponse aux questions qui se bousculent dans la tête de l’auditeur. Un Blues. Damned. Trahison. Et pourtant, le morceau sonne étrangement bien. La voix chargée d'excès du frontman, comme taillée dans un bloc de malt amidonné, porte le morceau à merveille. Et puis ce titre. "Whore house blues". Aller Lemmy, pour cette fois on ne t'en voudra pas d'avoir débranché l'ampli, on te doit bien ça après tout.
Sans être une pièce essentielle dans la discographie du groupe, cet Inferno a donc le bon goût de faire dans l’efficacité la plus primaire, et d’aucun remettrait en question la légitimité de sa présence au sein de cette sélection d’albums étiquetés "Hard rock". Son écoute est donc largement conseillée, si possible verre de Jack Daniel’s en main pour boire à la santé de son auteur…
Thomas

novembre 2004
Les années 2000 auront enfin vu l’œuvre colossale de Kyuss porter ses fruits. Même si le genre reste encore à l’heure actuelle cruellement underground à l’exception de quelques rares combos, nul hardos digne de ce nom n’ignore aujourd’hui le mot stoner. Merci qui ? Josh Homme, assurément, qui avec ses Queens Of The Stone Age a popularisé le genre et une pléiade d’obscurs artilleurs avec lesquels le bonhomme clame pourtant n’avoir rien en commun. Mais merci également John Garcia. Pendant que son ancien compagnon de jeu rencontre progressivement la gloire, le chanteur ne passe la seconde moitié des années 90 qu’à ruminer son sort, ballotant de projets mort-nés (formidables Slo Burn) en formations castrées par l’incurie des labels censés les mettre en lumière (fantastiques Unida). Quelques années après la séparation de Kyuss, le constat est clair pour l’ombrageux vocaliste : la musique ne sera plus un full-time job pour lui. Son rôle de père de famille est désormais prioritaire et il n’est plus question de quitter son désert natal pour se lancer dans de nouvelles chimères.
Sauf que, en ce début de millénaire, un collègue (le bassiste Dandy Brown, ex Orquesta Del Desierto) arpente le pays, décidé à monter un groupe de mercenaires désireux de consacrer à la musique en amateurs chevronnés, pour l’amour de l’art et non l’attrait des projecteurs. Le batteur Steve Earle (Afghan Whigs) et le guitariste Dave Angström (Supafuzz) répondent à l’appel. Angström introduit rapidement dans la bande son pote Garcia, et dès lors le projet Hermano prend une ampleur considérable. Un premier disque sort en 2002 (…Only A Suggestion) qui, dans la lignée d’Unida, perpétue à merveille l’héritage de Kyuss malgré sa brièveté (28 minutes). Mis en confiance par ce premier jet prometteur, le groupe récidive deux ans plus tard avec l’imposant Dare I Say… Alors que le second mandat de Bush annonce quatre nouvelles années de violence libérale et militaire, il oppose une réponse en forme d’affront, expédiée sans ménagement au locataire de la Maison Blanche avec le "Cowboys Suck" inaugural qui le rhabille pour l’hiver au moyen d’un binaire cinglant, fouettant le visage comme une volée de sable. Le quartet récidive quelques pistes plus tard avec l’explosif "Angry American", renchérissant dans la violence frontale avec une ardeur jubilatoire, et clôt les hostilités sur un corrosif "Let’s Get It On" à la fougue décapante, avec un narquois "You want a war ? You got a war !" jeté en guise de point final.
Mais la réussite de Dare I Say… ne réside pas simplement dans sa rage blasphématoire. Plus dense et varié que son prédécesseur, l’album conjugue puissance et assurance avec une maestria débridée. Excellant aussi bien dans le registre des charges compactes ("Quite Fucked"), des rengaines hypnotiques sur lesquelles les QOTSA ont bâti leur réputation ("Life") que des climats caniculaires ("Is This Ok?") ou éthérés ("On The Desert"), le groupe démontre avec brio sa capacité à s’aventurer sur tous les terrains. Mais la pièce maîtresse du gang reste sans conteste John Garcia. Son inimitable organe, sauvage comme un loup, venimeux comme un crotale, vorace comme une hyène, transcende chacune des 11 pistes de ce disque. C’est un véritable bonheur que de l’écouter scander avec détachement sur "Roll Over", mitrailler des "Go, motherfucker, go !" le long de "Brother Bjork" ou de montrer toute l’étendue de son registre vocal sur le poignant "My Boy". Le petit miracle d’un "Space Cadet" se reproduit ici sous les traits de "Murder One", formidable balade acoustique aux relents de whisky. C’est avec cette dynamique retrouvée que le groupe va enquiller en 2007 avec Into The Exam Room, toujours aussi abouti, et bientôt souffler ses 10 bougies.
Comment expliquer une telle longévité ? Par ce constat simple : les musiciens ont le même rythme de vie que leur chanteur. Chacun mène son existence dans son coin, conjuguant boulot (Dandy Brown est professeur d’anglais, Garcia travaille dans une clinique vétérinaire) et vie familiale, enregistrant ses parties dans son home studio pour les proposer ensuite à ses partenaires par mail. La troupe ne se réunit que pour des tournées de 2-3 semaines en Europe, renonçant pour le coup à sillonner un continent américain qu’ils connaissent déjà si bien. C’est cette espèce de force tranquille qui forme le ciment de la puissance et de la cohésion dont fait preuve Hermano sur chacune de ses réalisations. Chanteur casanier, John Garcia n’en oublie pas moins de multiplier les featurings pendant toute la décennie (Mondo Generator, Orange Goblin, The Crystal Method, Danko Jones, Monkey 3 jusqu’à récemment avec Karma To Burn), s’affairant mollement sur un album solo promis depuis des lustres et que le lascar ne semble pas pressé de boucler. Plutôt que de se carboniser à honorer un heavy rock dont il est l’un de ses plus illustres emblèmes, le bonhomme préfère le servir avec la sérénité et le détachement du vieux sage. La postérité louera ses titanesques travaux comme ils le méritent.
Maxime







