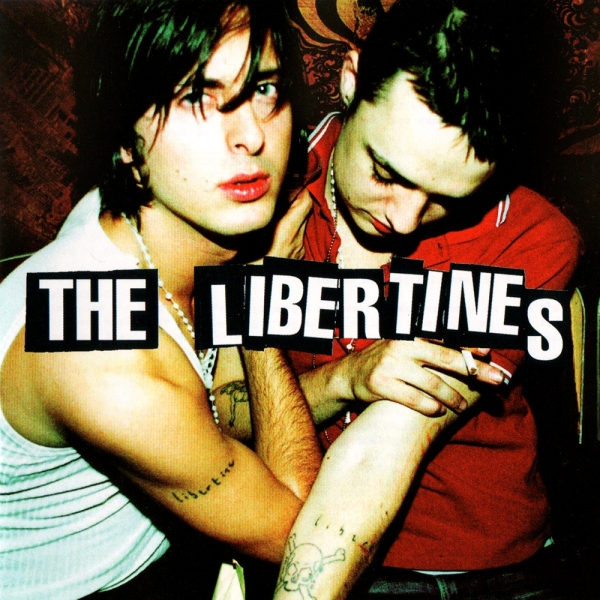The Strokes
Room on Fire
Produit par Gordon Raphael
1- What Ever Happened? / 2- Reptilia / 3- Automatic Stop / 4- 12:51 / 5- You Talk Way Too Much / 6- Between Love and Hate / 7- Meet Me in the Bathroom / 8- Under Control / 9- The End Has No End / 10- The Way It Is / 11- I Can't Win


Les dix années qui suivront ce fameux 30 juillet 2001 se sont apparemment évertuées à ne prouver qu’une chose : les Strokes n’avaient pour vocation qu’à être le groupe d’un seul album. Leur principale raison d’exister dans l’histoire du rock ? Réintroduire avec Is This It l’idée d’un binaire référencé, classieux, urbain, concis, retrouvant l’âpreté sensuelle des guitares, moderne dans sa coolitude, vintage dans ses fringues. Et après eux le déluge… On connait tous l'histoire. Bombardé malgré lui résurrecteur d’un rock dont les amateurs n’avaient jamais diagnostiqué le trépas (tout au plus une relative baisse de forme face l’avènement populaire de la techno), le combo new-yorkais fait songer à ces insectes mâles dont le destin est de mourir quelques heures après avoir fécondé la femelle. Poussé à son corps défendant par la presse à tenir un rôle de vigile qu’il n’avait jamais revendiqué, on attendait de lui qu’après avoir mis un pied dans la chambranle, il illumine la décennie à coups d’albums visionnaires et de slogans définitifs que reprendrait en chœur la génération MySpace. Il n’en sera rien. Ouvrant de longues années de redites, rancœurs et autres rendez-vous manqués, Is This It ne restera qu’un disque symptôme, condamné à rester figé en image d’Epinal de l’histoire du rock, chapitre "revival du début des années 2000". Vitrifiés par leur hold-up médiatique, les Strokes étaient déjà de l’histoire ancienne dès 2003.
La grande logique aurait voulu que Julian Casablancas et ses potes transforment l’essai par un disque dépassant en tous points Is This It. Ce toujours difficile deuxième album aurait dû se révéler prophétique, miraculeux, indépassable. Il se devait d’être une référence indiscutable qui dicterait au troupeau la marche à suivre, bref d’emboîter nonchalamment le pas à Nevermind et Ok Computer. La genèse de ce second opus tant attendu va dans ce sens puisque la troupe réquisitionne les services de Nigel Godrich, le Phil Spector contemporain et fameux sixième membre de Radiohead selon l’expression consacrée. Manifestement, on a voulu tailler un costard trop grand aux Strokes, celui de génies universels, alors qu’ils sont visiblement plus à l’aise dans les entournures slim de leur garage-pop convulsif taillé exactement à leur modeste envergure de jeunes gens doués bien décidés à ne pas forcer leur talent. Après plusieurs sessions stériles, Godrich est remercié pour laisser place à leur vieux complice Gordon Raphael.
Eberluée, la planète rock voit donc débarquer à l’automne 2003 un Room On Fire qui n’a d’incendiaire que le titre, succédant placidement à son prédécesseur, sans volonté affichée de lui faire de l’ombre. Partout on crie à la redite, à l’auto-plagiat frileux. Pourtant, le groupe a consenti à entreprendre les aménagements nécessaires. Il quitte l’axe Velvet Underground/Iggy Pop/Modern Lovers pour s’inscrire dans le sillage de formations avec lesquelles il partage finalement davantage d’affinités, Cars, XTC et Blondie en tête, autrement dit ces combos à la charnière entre deux époques, la fin rebelle des seventies et le lustre kitsch des eighties naissantes. Cet opus, le cul coincé entre les relents nicotiniques du CBGB et la grâce plastoc de la New Wave, a valeur de manifeste esthétique, délivrant un rétro-futurisme aussi suranné que les décors d’Orange Mécanique. A l’exception du micro saturé de Casablancas, les tics minimalistes disparaissent du paysage, la production renonce quasiment à tout grain artificiel, la basse ronronne enfin de tout son poids replet. Room On Fire n’offre ainsi pas plus que ce que Is This It proposait : 11 titres nerveux ou boudeurs qui s’appréhendent dès le premier passage, plaisants et accrocheurs. Le grand mérite des Strokes reste avant tout d’avoir remis au goût du jour le format pop des mid sixties, soit une grosse demi-heure de musique qui ne s’essouffle jamais et ne se perd pas en divagations superflues. On tourne enfin la page des années 90, lesquelles, avènement du CD oblige, s’étaient entêtées à livrer des brouets indigestes de 15-16 plages farcis de morceaux bouche-trous et de ghost tracks inutiles pour combler ces satanées 80 minutes d’espace disponible. A bien y regarder, rares sont les groupes qui brilleront sur ce format à la suite des new-yorkais : Franz Ferdinand, Kings Of Leon (à leurs débuts), Arctic Monkeys, Weezer jusqu’en 2003. Et puis qui ?
Délivré de l’effet de surprise, le quintette brille enfin de sa force sereine. Sans avoir l’air d’y toucher, il dégaine une belle collection de tubes aux refrains maussades ("12 :51"), nasillards ("The End Has No End") et urgents ("Reptilia"). Délaissant les clichés frelatés du garage-punk new-yorkais pour n’en conserver que l’énergie, toujours foncièrement old-scool dans sa rectitude, le groupe déambule avec un chic affecté entre power-pop morveuse ("Meet Me In The Bathroom", "I Can’t Win") et rengaines narquoises ("Automatic Stop", "Under Control"). Le but reste inchangé : enquiller une petite dizaine de morceaux qui retrouveraient l’équilibre magique d’un "Paperback Writer", d’un "Midnight To Six" ou d’un "Ever Fallen In Love". C’était un peu perdu d’avance, mais l’intention reste louable, surtout que le groupe se montre à nouveau d’une cohésion à toute épreuve. Les guitaristes Albert Hammond Jr. et Nick Valensi se lancent dans des duels stéréophoniques comme dans les grandes heures de Television, tandis que Nikolai Fraiture compte les points en admonestant un éboulis de grooves dont le minimalisme rejoint les frontières de l’autisme. L’un mouline en mâchouillant son chewing-gum tandis que l’autre sabre en plissant son visage de petit minet. Les riffs dialoguent avec élégance, quadrillent l’espace en abscisses et ordonnées punky-pop, débitent des gimmick astucieux (la ligne de guitare doublant le couplet de "12 :51", l’intro de "The End Has No End"), couinent dans les breaks ("Reptilia"), taraudent sur la rythmique avec une morgue robotique ("Automatic Stop", "Meet Me In The Bathroom"), jaillissent avec avidité dès que la machine s’emballe ("The Way It Is"). Un véritable ping-pong guitaristique, aussi vif et intense qu’insolent tant il ne respire jamais le labeur ni la démonstration stérile. Les Strokes restent plus jamais à des lieues de la concurrence.
Pendant que ses potes déroulent le programme avec application, Julian Casablancas reste fidèle à lui-même, geignant les mâchoires serrées, manifestement toujours gêné d’être là, rejetant le CDD au poste de rock star générationnelle d’un air las. Tournant les talons à cette mascarade, le bonhomme préfère trousser quelques rimes chétives narrant sa récente rupture amoureuse. Mais rien ne nous empêche de leur trouver un sens caché. Que comprendre, lorsque les premiers mots qui ouvrent l’album sont les pléonastiques "Je veux être oublié, et je ne veux pas qu’on se souvienne de moi" ? Une déclaration d’intention destinée à calmer tout le monde. Room On Fire ne sera pas un signe de renouveau, il montre au contraire des Strokes résolus à retourner vers l’ombre de leurs débuts, souhaitant redevenir des soldats anonymes de la cause. Face à la décennie qui s’installe et qui sera encadrée par les attentats du World Trade Center et la crise économique (deux catastrophes dont l’Amérique est à la fois le coupable et la victime), Casablancas aligne sa position sur celle des futurs MGMT et Late Of The Pier : haussement d’épaules généralisé, circulez y’a rien à voir. Que dire face à ce monde flou, cette époque molle, fatiguée mais qui ne s’embrase jamais, quand il n’y a pas d’ennemi défini mais une invisible chaîne de micro-renoncements qui nous rendent tous un peu co-responsables ? Répondre par une colère larvée aux frontières de l’apathie. Incommunicabilité ("Automatic Stop"), recherche de substituts à l’ennui ("Reptilia") et résignation ("You Talk Way Too Much", "I Can’t Win") dominent les débats. Le constat de la jeunesse des années 2000 est clair du côté Casablancas : "Je ne veux pas changer ton esprit, je ne veux pas changer le monde, on est jeunes mais on est sous contrôle." Un bilan désabusé finalement bien plus violent dans son amertume que n’importe quelle diatribe fracassante.
Pourquoi alors sacrifier tant d’énergie à évoquer ce Room On Fire, disque déterminé de la première à la dernière seconde à ne pas sortir du rang ? Parce qu’il est le dernier témoignage discographique de ce que les Strokes auraient toujours dû rester. Un groupe de power-pop qui, dans la lignée des Cars ou des Replacements, aurait aligné 4-5 disques formellement modestes et mélodiquement entêtants avant d’arrêter l’affaire sur une chaleureuse poignée de main, le sentiment du devoir accompli. Au lieu de quoi on les a forcés à enregistrer ce satané grand album, qui ne fut pas Room On Fire mais son successeur, First Impressions Of Earth. Surgonflé par une production obèse, le disque fit illusion lors des premiers tours de piste avant de prendre rapidement la poussière. Depuis, chacun papillonne en solo. Albert Hammond Jr. se révèle être un petit songwriter honnête tandis que Casablancas s’obstine dans son trip eighties. Pourtant, tout le monde s’acharne à les voir réunis à nouveau, alors que les musiciens n’ont visiblement plus envie de jouer ensemble. Qu’attendre d’un quatrième album dont la gestation s’est déroulée dans une ambiance qu’on qualifiera pudiquement de délétère ? Tandis que la multitude se précipitera sur cette déception annoncée, on préfèrera écouter, toujours et encore, ce Room On Fire, humble post scriptum de cinq types très doués et un peu désenchantés.