
Discorama 2000's : les incontournables pop
- Introduction
- 2000-2001
- 2002
- 2003-2004
- 2005-2007
- 2008-2009
2000-2001
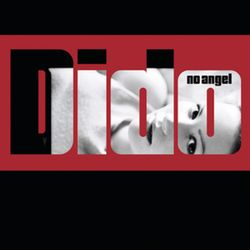
juin 1999 (USA) - mars 2000 (Europe)
Parce que pop rime aussi avec mainstream, et que mainstream n'est pas forcément synonyme d'indigence, il est difficile d'omettre le premier album de Dido dans ce palmares. Fruit de longues années de compositions et d'arrangements, No Angel est le dernier des grands disques phénomènes des années 2000, l'un des derniers à avoir franchi la barre fatidique des 20 millions de copies écoulées. Ce succès tonitruant, même s'il peut être mis en grande partie sur le compte du fameux single "Stan" d'Eminem qui sample le "Thank You" de la belle anglaise, ne doit pourtant rien au hasard.
Habile mélange de pop FM et d'électro soft (médiée par le frère de Dido et producteur du disque, Rollo Armstrong, l'un des membres fondateurs de Faithless), parfaitement servi par la voix chaude et sensuelle de la chanteuse, l'album s'ouvre sur deux singles ultra-diffusés sur les ondes FM, "Here With Me" et "Hunter", s'appuyant sur un peu de lyrisme symphonique pour mieux équarrir le terrain. Si les deux titres pré-cités et le sémillant "Don't Think Of Me" déroulent un mid-tempo particulièrement inspiré mais tout à fait classique pour du FM-compatible, le reste de l'album s'avère en revanche beaucoup plus calme et contemplatif, et c'est là qu'il prend ses véritables marques de noblesse. On pourra ainsi se délecter d'un magnifique "My Lover's Gone" drapé dans ses plages de synthés en apesanteur et concassé par une rythmique presque tribale en arrière fond, des superbes décalages majeur - mineur qui irradient "Thank You" d'une beauté proprement lumineuse, des troublants enchevêtrements vocaux qui portent à bout de bras un "Slide" à l'attraction littéralement magnétique, ou encore des ingénieux lacis de synthés à tonalité surnaturelle qui s'évadent de "Honestly OK" et qui assurent une mise en orbite élégante à un doux refrain atmosphérique. Ailleurs, on pourra savourer à l'envi les percussions étranges d' "Isobel", contrastant de façon éblouissante avec une mélopée aussi suave que câline, ou encore le classicisme feutré d'un "I'm No Angel" transporté par une merveilleuse mélodie aussi pudique que généreuse. Notez que ce qui frappe ici, c'est la retenue et la modestie d'un chant qui se retrouve transfiguré par des textes doux-amers, tournant autour du lit conjugal et qui respirent une sensualité aussi troublante que désespérée. Ainsi l'auditeur se voit-il embarqué malgré lui dans une lente exploration de la psyché féminine, voyage conclu par le calme rêveur d'un "My Life" acoustique contrastant avec l'immersion hallucinée d'un "Take My Hand" rythmé par des beats débordants d'urgence et qui occultent presque les grandes orchestrations explosant dans le décors.
No Angel est un disque simple et beau (au sens fort du terme), aussi élégant que charnel, et dont aucun morceau ne mérite d'être mis à l'écart, pas même un "All You Want" qui se laisse pourtant aller à une certaine facilité (en tout cas par rapport aux autres titres). Un disque au charme rêveur, une ode à la féminité et à la plénitude amoureuse, et probablement l'un des albums que l'on peut le plus facilement faire tourner en boucle sur une platine CD sans craindre la moindre lassitude - et ça, ce sont de longues années passées en compagnie de ce disque qui peuvent en témoigner. Comme quoi, tout ce qui passe sur les ondes FM n'est pas forcément synonyme de poubelle...
Nicolas
lire la chronique de l'album

juillet 2000
On aurait pu un temps se demander qui allait remplacer les chantres de la britpop dans le cœur des anglais à l'aube du troisième millénaire, qui allait succéder aux Oasis, Blur, Suede et autres Supergrass pour enchanter les âmes et ravir les oreilles. Si le doute fut un temps permis, le virage ouvertement expérimental de Radiohead avec Kid A et le split éclair de The Verve peu après la sortie de Urban Hymns a rapidement laissé un boulevard à une nouvelle génération d'acteurs britishs pop plus mesurés et classiques que leurs aînés, bien que ne niant nullement leur paternité héritée des 90's. Parmi toutes ces nouvelles formations anglaises de talent cherchant avant tout à engendrer une vraie musique populaire (au sens noble du terme), parmi les Keane, Kaiser Chiefs, Travis, Doves et autres Kasabian, et alors que Muse se retrouvait, pour un temps au moins, légèrement boudé outre Manche, c'est sur un groupe issu de l'upper-class londonienne que se tournèrent tous les regards dès le milieu de l'an 2000. Car avec Parachutes, Coldplay venait de marquer véritablement son époque.
Comme tous les grands disques, Parachutes fut enfanté dans la douleur. Très vite repérés par Parlophone alors qu'il écumaient les clubs anglais depuis à peine une année, les quatre membres du jeu froid embrayèrent sur l'écriture de leur premier album studio dans une certaine confusion. Tandis qu'un EP apéritif (The Blue Room) était en cours d'élaboration fin 1999, de vives tensions internes entrainèrent la mise à pied de Will Champion, éjecté par un Chris Martin alors ulcéré par son comparse. Pour autant le batteur accepta de réintégrer les rangs de Coldplay quelques semaines plus tard, Martin ayant compris que la cohésion de son effectif avait été fortement ébranlée par ce départ. En vérité l'homme et ses acolytes se retrouvaient paralysés par l'enjeu de ce premier opus studio, conscients d'un énorme potentiel vanté par tous les imprésarios qui croisaient leur chemin, mais malades de trouille à l'idée de faire un faux pas qui pourrait enterrer définitivement leur carrière. Par ailleurs, la première expérience studio au sein d'une major ne s'était pas révélée concluante, la formation ayant été très peu satisfaite des prestations du producteur Chris Allison alloué au Blue Room EP (et responsable de la mise en boîte du single "High Speed"), lui reprochant notamment de trop imposer ses méthodes de travail et ses arrangements.
C'est à cette époque que Coldplay croisa le chemin de Ken Nelson, professionnel peu connu qui avait auparavant fait ses classes auprès du groupe Gomez, la rencontre ayant eu lieu lors d'un concert réunissant les deux formations. Immédiatement saisi par la voix chaude et affectée de Chris Martin, Nelson notait pourtant que le groupe semblait excessivement crispé sur scène, enchaînant les titres à un tempo trop élevé et renvoyant aux spectateurs une image brouillonne et fiévreuse. Son plus gros travail, une fois nommé officiellement à la production de l'album, fut d'apprivoiser ces jeunes musicos stressés, de les mettre en confiance et d'apaiser leurs élans artistiques. Les membres de Coldplay prirent donc tout leur temps pour peaufiner leur premier bébé, et l'enregistrement de Parachutes, initialement planifié sur deux semaines, finit par s'étaler de septembre 1999 à mai 2000, les séances de studio se retrouvant entrecoupées par de longues périodes de tournée. Le travail s'éparpilla entre les studios Rockfield, Matrix, Wessex Sound, mais surtout Parr Street de Liverpool dans lequel la majorité de l'album fut captée. Là encore dans un soucis de simplicité et de dépouillement, le plus gros des prises à Parr Street fut effectué dans une salle basique qui servait à l'origine à enregistrer des démos. Tous les éléments furent ainsi rassemblés pour que le groupe accouche d'un petit chef d'œuvre de pop classe et romantique. D'ailleurs, la suite est parfaitement connue : sorti en juillet 2000 au Royaume Uni, le disque réalisa un carton monstre en se classant rapidement en tête des charts, et rafla la quasi-totalité des récompenses de l'époque (Q Award 2000, Brit Award 2001, Grammy Award 2002). Seul le Mercury Prize échappa à Chris Martin et à sa bande au profit du peu connu Badly Drown Boy. L'affaire de succession énoncée en préambule se retrouva ainsi pliée dès l'aube du troisième millénaire : l'Angleterre s'était enfin trouvée de nouveaux champions pour porter haut les couleurs de l'Union Jack dans les hits parade du monde entier.
Il est aujourd'hui difficile d'évoquer cet album sans le mettre en perspective vis-à-vis de ses successeurs. Moins rêche que A Rush Of Blood To The Head, moins pop FM que X&Y, moins m'as-tu-vu que Viva La Vida, Parachutes séduit avant tout par sa simplicité, son dépouillement et sa sincérité. Et de fait, étant donnés les incroyables talents de vocaliste de Chris Martin, le groupe n'a aucunement besoin de souligner au fluo ses traits mélodiques ou de noyer ses harmonies sous des excès de production. Ken Nelson l'a parfaitement compris à l'époque sur cette réalisation, même si la limpidité d'intention du quatuor s'est vue partiellement occultée sur les deux opus suivants. Ici, pas d'esbroufe inutile, Coldplay a fait le choix de se révéler sous son jour le plus virginal en n'alignant que le strict nécessaire : un chanteur à la classe incommensurable, une guitare électrique aérienne, omniprésente dans sa résonance et dans ses réverbérations caressantes, quelques riffs acoustiques obsédants, un piano emprunt de sérénité fluide, une assise rythmique pudique et enveloppante, et rien de plus. L'alchimie formelle gagnante de Parachutes se met ainsi au service de mélodies voluptueuses, recherchées, sensibles, tristes également. Mais - et c'est là que l'on sort de l'ordinaire - malgré cette apparente noirceur, les intonations vocales de Martin ont tôt fait de nous faire naviguer de cafard rêveur en béatitude solaire, de spleen ouaté en félicité gracile, extirpant ainsi les morceaux de leur pathos pour les hisser vers la lumière. Si on ajoute en plus des textes poétiques forts, recourant fréquemment à la mise en image des émotions et à la mise à plat des sentiments humains (comme cette toile d'araignée dans laquelle s'emmêle le protagoniste de "Trouble" qui nous renvoie à un sac de nœud sentimental inexorable), on obtient une perle de pop rock émouvante et gracile qui n'a pratiquement aucun équivalent en Angleterre ou dans le reste du monde - Elbow mis à part.
Chaque morceau se révèle être un petit joyau de finesse et de justesse émotionnelle, entrainant l'album dans des cimes de contemplation rassérénante et suscitant dès les premières secondes chez l'auditeur une sensation de flottement et de plénitude. Même si les cordes laissent parfois l'électricité décharger des torrents de sentiments réprimés ("Shiver" et les riffs gras de son refrain, "Yellow" et les martèlements rythmiques de son motif principal), on ressent toujours le calme et la contenance inaltérable du groupe à chaque seconde qui s'écoule. Le songwriting y est tout simplement magnifique, prenant un envol inégalable lors des passages les plus humbles où ne s'élèvent qu'une gratte sèche ensorcelante ("We Never Change", "Parachutes") ou un piano élégiaque ("Trouble"). On flirte parfois avec le cabaret-bar chicos emprunt de sensibilité jazzy ("Sparks", "Everything's Not Lost"), alors qu'ailleurs les lignes de voix et de guitares s'entremêlent en un tourbillon harmonique placide ("Don't Panic"). Coldplay excelle véritablement dans les mélanges de sonorités acoustiques et électriques soft ("Spies" en est l'exemple le plus réussi), réalisant des bijoux somptueux éclairés par l'organe chaleureux de Chris Martin, l'une des plus belles voix de la pop anglaise actuelle, à la fois lointaine et détachée de par sa préciosité mais amenant une proximité rassurante grâce à la chaleur de son timbre. Vous l'avez compris après ce torrent d'éloges, Parachutes est un incontournable absolu de la dernière décennie, un petit chef d'œuvre de pop ouatée et délicate, un trésor musical à écouter en boucle sans repos, si possible à la nuit tombée, au casque et dans le calme le plus absolu. C'est grâce à cet album que l'on continuera à épier du coin de l'oreille les réalisations futures de Coldplay, même si nous n'avons pu que prendre acte du virage inexorable entamé par le groupe vers une pop de masse prompte à régaler les stades, à mille lieue de la pudeur de ce premier opus en tous points remarquable. L'espoir fait vivre, et même si Viva La Vida en a ulcéré beaucoup à la rédaction, il n'est pas interdit de rêver à une nouvelle réalisation de la trempe émotionnelle de ce Parachutes.
Nicolas
lire la chronique de l'album
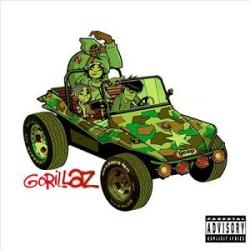
mars 2001
Le lutin Damon Albarn a surpris tout le monde avec le succès du premier album éponyme de Gorillaz. La critique était sceptique mais n'a pu que s'incliner face à l'éclectisme qui ressort de ces quinze pistes aux influences au moins aussi diverses et variées que ceux qui les ont engendrées. La projet fut fondé au début de la décennie par un chanteur de Blur voulant explorer de nouveaux horizons et trouvant chez Jamie Hawlett, le dessinateur de la BD Tank Girl, un partenaire de choc pour un projet dingue : un groupe schizophrène composé de personnages virtuels possédant leur propre histoire et désireux de fonder un band d'enfer. 2D, chanteur-pianiste aveugle et dépressif, Murdoc, bassiste punk et plutôt crade responsable de la cécité de son camarade, Russell, batteur hip hop possédé par l'esprit de ses amis décédés et Noodles, guitariste asiatique amnésique et hyperactive.
Albarn et Hawlett engagent le producteur Dan The Automator pour leur premier opus et s'entourent de camarades de jeu venant d'horizons très différents pour faire de cet album une véritable soupe primitive de la musique moderne. Entre trip hop, britpop, hip pop, rock, ambiant et dub, Gorillaz se forge une identité derrière le mystère qui l'entoure et l'entretient sous ses ambiances brumeuses et un univers sonore prenant à la limite du easy listening mais avec une touche unique et accrocheuse. La basse se fait ronde et profonde, les beats secs et groovy, et autour de cette rythmique se brodent la voix paresseuse d'Albarn et celle des artistes invités pour l'occasion, entre autres Del Tha Funky Homosapiens offrant son flow au single "Clint Eastwood" et Ibrahim Ferrer du Buena Vista Social Club œuvrant sur la très hispanisante "Latin Simone".
Gorillaz s'ouvre sur un "Re-Hash" catchy et sa guitare folk grinçante, morceau introduisant d'emblée les bases sonores de l'album, toutes en textures, riches de claviers, effets électro et voix entrelacées. "5/4" fait honneur à son nom avec son groove irrégulier et son riff à l'efficacité ravageuse avant de s'envoler dans une montée délirante. Toujours avec autant de richesse, l'album s'enfonce dans des méandres plus stagnants, trainant du côté d'un marécage un peu glauque avec "New Genius (Brother)" et "Sound Check (Gravity)" ou de la dépression chronique de 2D dans le single "Tomorrow Comes Today", tous trois témoins des nombreux arrangements qui se laissent entendre en toile de fond. La voix de Damon Albarn fait des miracles avec son timbre aigu si particulier, s'en donnant à cœur joie sur des morceaux plus minimalistes comme "Man Research (Clapper)". En parlant de minimalisme, "Double Bass" en est un exemple criant de répétitions et d'hypnotisme, succédant à une certaine réminiscence de britpop avec un "Punk" débridé aux claquements de mains pop à souhaits et aux accords sèchement balancés, ce même genre d'accords que l'on retrouvera sur la merveille de cet album, "M1 A1", après ces notes angoissantes, cette guitare crescendo et cette voix terrifiée : "Is there anyone there ? Hellooooooooooooo...".
La production de Dan The Automator se révèle d'une puissance et d'une clarté incroyables, bourrée de détails presque imperceptibles qui lient les morceaux entre eux au fil de l'album dans une atmosphère palpable et évocatrice, installant discrètement de légers arrangements, alternant harmonies subtiles et délires électroniques. Le duo Albarn/Mito Hatori sur "19/2000" peut prendre la tête facilement mais possède un potentiel de bonne humeur terrible, comme l'atmosphère insouciante et reposante de "Slow Country". Toutes deux contrastent de fait avec l'autre perle de l'album, la planante, nocturne et céleste "Starshine", témoin de la facette dub de Gorillaz et du talent invétéré du groupe pour les mélodies simples et redoutables, s'ancrant dans le crâne sous la voix apathique de Damon Albarn.
Cet album mérite sans doute possible sa place dans un tel discorama, pas seulement de par sa grande palette d'ambiances et d'influences, mais du fait de cette facilité d'accès bien connue du caractère de Damon Albarn. De plus, en jouant la carte du multi support, Jamie Hawlett a réalisé des clips de grande qualité qui sont pour beaucoup dans le succès de Gorillaz. Il est pour certains la seule œuvre vraiment mémorable du groupe qui a multiplié les récidives avec de plus en plus d'invités et d'ouverture mais avec peut être moins d'originalité et de fraicheur que ce premier opus, désormais culte.
Geoffroy
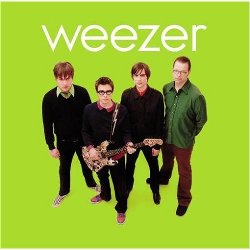
mai 2001
Où Weezer signe l’un des come-back les plus fracassants de la décennie. On croyait le groupe terminé, lessivé oublié, croupissant dans la crypte alternative avec tant d’autres formations nées au mauvais moment, au milieu des années 90, cette période étrange s’étalant du déclin du grunge au triomphe du nu-metal où le rock n’avait plus vraiment droit de cité. Depuis 1996, Rivers Cuomo végète dans un véritable purgatoire. Traumatisé par le four critique et public de Pinkerton, frustré par son cursus à Harvard qu’il n’arrive pas à boucler, lâché par le bassiste Matt Sharp parti chez les Rentals, le binoclard sombre dans une paranoïa maximale. Cloîtré de longues années durant dans sa maison dont il a intégralement repeint les murs en noir, le bonhomme rumine ses échecs et ses déceptions. 121 chansons sont fébrilement ébauchées à l’abri du monde, le jeune ermite ne souffrant que la compagnie de ses musiciens venant lui rendre visite lors de brefs passages.
Voilà peut-être l’une des premières manifestations concrètes de l’incidence d’Internet sur le petit monde du rock. Des forums se montent, les morceaux circulent et les langues se délient. Pinkerton se voit peu à peu voué un véritable culte, vénéré par des communautés de nerd mal dans leur peau et de mélomanes un peu geek sur les bords. Une foule souterraine se met à se demander ce qu’a bien pu devenir son groupe de chevet. Eberlués, Cuomo et sa troupe voient les gens affluer à leurs concerts alors qu’ils entament une courte tournée au Japon et un passage au Warped Tour durant l’été 2000. Geffen flaire la demande et ordonne bien vite à ses obligés de se remettre au travail. Le Cars Ric Ocasek est de nouveau appelé à la rescousse, taillant dans la masse de titres composés pour n’en préserver que l’essentiel, gouvernant la production au téléphone depuis son appartement de New-York tandis que le groupe, renforcé par l’arrivée de Mickey Welsh derrière la 4-cordes, jamme dur à Los Angeles.
Le Blue Album avait rompu la glace polie des charts américains à coups d’hymnes radieux ("Buddy Holly") et de singles chancelants ("Undone"). Le Green Album vient rompre les sept ans de malheurs consécutifs : Rivers Cuomo reste ce petit être chétif et complexé, songwriter de poche aux moyens limités et aux possibilités immenses. Sous la bannière d’un code visuel volontairement fidèle à ses débuts (le groupe rassemblé sur un fond uni), Weezer amorce un retour aux sources inespéré. Le mariage entre mélancolie et mélodies imparables fonctionne comme au premier jour, et se pare même d’une efficacité implacable. Les guitares sont surpuissantes, la production n’autorise aucun écart superflu, et la voix de Cuomo reste pourtant aussi acidulée que touchante. Les riffs décharnés de Nirvana copinent avec les couplets bubble-gum ("Don’t Let Go"), les rengaines amères ("Crab", "Glorious Days") et de légers accès de teenage angst aigüe cramée au bang ("Hash Pipe"). Il se dégage de ces 10 pistes un mélange paradoxal d’assurance, presque enjouée par moments, et de profond mal-être, chacun nourrissant l’autre en une harmonie fragile. On pense plus que jamais à Brian Wilson sur ces refrains aux allures de suppliques ("Smile") et ces historiettes pleurant un été révolu ("Photograph"), quand ce n’est pas à Black Francis que l’on songe lorsque le "O Girlfriend" terminal embrasse torrents de larmes et fracas de Marshall dans une même étreinte. Le groupe parvient même à faire de "Island In The Sun" un tube planétaire, ratissant bien au-delà de son cercle de fans. La multitude sera bercée tout l’été 2001 par une chanson lumineuse révélant de véritables gouffres de mélancolie derrière son apparente naïveté, comme "Wouldn’t It Be Nice" en son temps. Hold-up parfait.
Il ne faut pas plus de 28 minutes à Weezer pour tacler la concurrence et reconquérir son statut de meilleur combo power-pop en activité. Titre qu’il n’a aucune peine à revendiquer, car la formation reste sans challenger sur son terrain, sachant marier la bonne dose de sucre et d’acide contrairement à Stereophonics, ne pas jouer inutilement du muscle en refusant de prendre exemple sur les trop orthodoxes Foo Fighters et ne pas s’abaisser au niveau du pop-punk scato de Blink 182. La génération Strokes est également prévenue : il faudra compter avec eux, et Rivers Cuomo reprend en toute logique sa place centrale sur l’échiquier, lui qui n’a pas besoin de sonner vintage pour s’imposer. Les choses vont pourtant très vite se gâter. Après un Maladroit rendant un hommage euphorique et jubilatoire au hard de sa jeunesse, Weezer cessera son parcours sans faute en accumulant depuis des réalisations qu’on qualifiera poliment de dispensables. Pas moins de 6 albums sortent dans cette décennie, et la qualité va sans cesse decrescendo au même rythme que la vie du frontman prend une tournure de plus en plus radieuse. A tel point que les fans se sont mis à signer des pétitions pour implorer leur idole de cesser cette désolante diarrhée créatrice. Adulte aujourd’hui heureux, Cuomo se montre bien moins inspiré que lorsqu’il était jadis un post-ado gauche et emprunté. Problème : personne ne semble actuellement de taille à lui succéder.
Maxime
lire la chronique de l'album
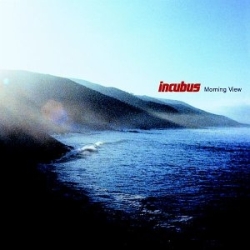
octobre 2001
Phénomène des 90’s, comme le grunge, la fusion (mélange de genres musicaux : rap/metal, funk/rock…) se craquelle doucement à l’approche du nouveau millénaire. Des grands noms (Faith No More, Red Hot Chili Peppers ou Rage Against The Machine), il ne reste pas grand chose, comme si la formule avait fait son temps. En cette période de crise, Incubus, frère d’arme des Red Hot, décide de se dévoiler sous une nouvelle facette. Mettant de côté l’explosivité qui avait fait le bonheur des fans de S.C.I.E.N.C.E., le groupe se tourne vers une approche musicale résolument plus pop, pleine de cordes, de chœurs cristallins et d’arrangements fouillés, tout en évitant de tomber dans le refrain mielleux.
Car, au risque de raviver de vieilles querelles, on peut aujourd’hui l’affirmer, Morning View, en plus d’être le meilleur album d’Incubus, est un grand disque de pop. Brandon Boyd et sa bande ont pris le parti de pondre un disque de synthèse où se retrouvent en vrac le meilleur du metal FM, de jolies mélodies et une volonté toujours affichée d’amener son grain de sel à l’édifice de la musique. Pour faire le lien entre l’énergie funk des débuts et son nouveau côté pop, le disque débute avec deux titres pieds au plancher, agréables sans être renversants. Rapidement pourtant s’ouvrent les portes d’un univers doux et reposant. Après "Wish You Where Here", passerelle entre l’ancien et le nouveau monde d’Incubus, les Californiens délivrent "Just A Phase", matrice de ce qui va suivre. Tout y est : la voix de Boyd, presque (trop) parfaite, les lignes de basses groovy, les scratch légèrement divulgués et une structure ultra efficace en forme de longue montée en puissance. Puis, Morning View distille tranquillement ses arguments. Des ballades épurées ("Mexico", "Warning") ou aux arrangements fouillés ("Aquous Transmission"). Des morceaux pêchus ("Are You In", "Have You Ever") portés par des guitares musclées et une section rythmique efficace. Un travail de production très propre fait le reste et permet à l’album de s’installer durablement dans la conscience de l’auditeur. L’atmosphère reposante qui s’en dégage est celle des matins ensoleillés passés à regarder les vagues s’écraser sur les rochers en contrebas.
Pierre
lire la chronique de l'album







