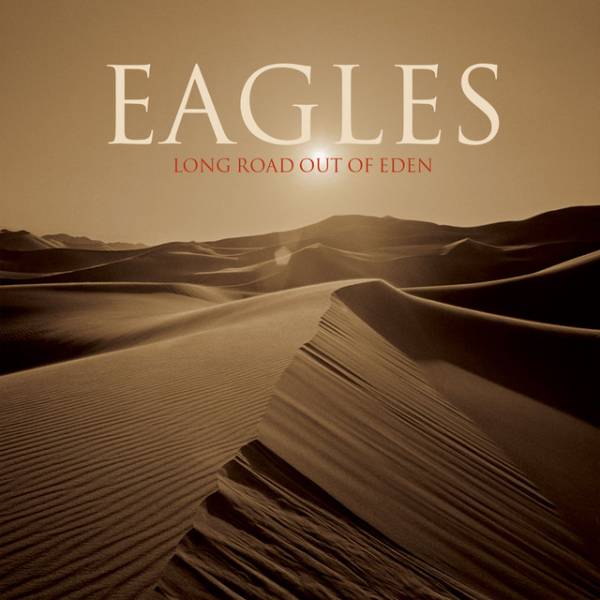Eagles
Hotel California
Produit par
1- Hotel California (LP Version) / 2- New Kid In Town (LP Version) / 3- Life In The Fast Lane (LP Version) / 4- Wasted Time (LP Version) / 5- Wasted Time (Reprise) (LP Version) / 6- Victim Of Love (LP Version) / 7- Pretty Maids All In A Row (LP Version) / 8- Try And Love Again (LP Version) / 9- The Last Resort (LP Version)


Question
Trente-deux millions d’exemplaires vendus…
Trente-deux millions...
Est-il vraiment nécessaire d’encore approfondir l’analyse ?
Réponse
Oui. Plus que probablement.
Les chiffres de vente astronomiques ont fait de Hotel California un classique, un intouchable, un monument, un monstre. Et pourtant, c’est un album extrêmement déprimant.
Il a même tué les Eagles (1). Et ça, ce n’est vraiment pas banal... Parce que, originellement, le groupe était, à l’instar de son merveilleux totem, appelé à voler longtemps et très haut.
Musicologie appliquée
Avant d’aborder le fond du sujet, il importe de souligner l’extrême fair-play de Ian Anderson qui a simplement déclaré "Good Job" en découvrant que "Hotel California" (le titre) était copié note pour note sur son excellent "We Used To Know" (sur Stand Up en 1969).
On a souvent hurlé au plagiat pur et simple pour beaucoup moins que ça… Posez la question à Richard Ashcroft, par exemple.
Concept
1976. Les États-Unis ont 200 ans.
Entre illusion(s) et réalité(s), que reste-t-il du rêve fondateur américain ?
La guerre du Vietnam a été une défaite cinglante. Le disco a envahi le spectre sonore. Tout le monde se fout des élections présidentielles. Au cinéma, il y a Rocky, The Omen ou Taxi Driver. En littérature, Tom Robbins publie le prémonitoire Even Cowgirls Get The Blues.
Dans la vraie vie, le Sida, signalé à New-York dès 1971, a migré jusqu’à San Francisco...
Pour un Européen, la question du "rêve américain" peut paraître théorique ou même pusillanime. Mais, pour beaucoup d’Américains, c’est vraiment une préoccupation essentielle. De Bob Dylan à Bruce Springsteen, en passant par Styx (2), John Fogerty, Sparks (3), CSN&Y, The Dead Kennedys, Green Day, …, ils sont nombreux à s’être posé – avec angoisse – des questions très existentielles sur la possible déliquescence de la culture héritée de leurs pères fondateurs.
D’un bout à l’autre, Hotel California est basé sur cette (seule) question conceptuelle, sachant que, par licence poétique, l’album résume le pays-continent à sa seule Californie (4) puis la seule Californie à l’une de ses cliniques spécialisées dans le traitement des addictions.
L’Amérique : une clinique et une prison… Symbolique, non ?
You can check-out anytime you like
But you can’t never leave… (5)
Horriblement désabusé, (ab)usant des tonalités mineures, le propos général ne laisse aucune place à l’espoir. Les addictions sont incurables, les amours promises à la rupture, le sexe désespéré, les rêves d’enfants illusoires, le succès trop éphémère, l’environnement détruit (ou en voie de destruction), les droits des américains natifs (vérifier) bafoués, l’art et la culture voués à l’oubli.
Pas de quoi (faire) rêver. Autrefois symbole de beauté, de force, de prestige et de domination, l’Aigle semble avoir perdu quelques-unes de ses plus belles plumes et volette désormais en rase-mottes.
Sang nouveau
Après le départ brutal de Bernie Leadon (6), leur excellent gardien du temple country (7), les Eagles recrutent le fantasque Joe "Machine à Riffs" Walsh. Le pari est risqué parce que le guitariste, chanteur et claviériste évolue dans un monde rock beaucoup plus « sauvage » que l’univers country soft dans lequel le groupe a patiemment fait son nid.
Le mariage ne sera jamais vraiment consommé et il faut bien admettre que, partagé entre plusieurs dimensions stylistiques qui ne s’harmonisent pas toujours, l’album ne tient pas vraiment la route de bout en bout.
Les trois sublimes premiers titres - "Hotel California" (sous réserve de son "plagiat"), "New Kid In Town" et "Life In A Fast Lane" font évidemment illusion et donnent l’impression de visiter une infatigable usine à hits.
En clôture de la face A du vinyle, "Wasted Times" oublie définitivement les racines country rock pour des arrangements un peu plus "sucrés" qui lorgnent vers ce Philly Sound (8) légèrement asthénique, fort populaire aux States au mitan des seventies. La forme – parfaite au demeurant – l’emporte (joliment) sur le fond.
En ouverture de la face B, une brève reprise orchestrale du thème de "Wasted Times" fait figure de simple enjolivure.
"Victim Of Love" permet à Joe Walsh d’affirmer ses racines hard avec un titre vraiment bombastique dont le refrain est admirablement servi par des chœurs ciselés.
Malheureusement, les titres suivants s’enlisent progressivement dans une forme étrange de spleen. Malgré son grand piano majestueux et une certaine sorcellerie dans sa progression mélodique, le fort ambigu "Pretty Maids All In A Row" s’avère vaguement mou du genou, au même titre que le peu intéressant "Try And Love Again" lequel vaut principalement pour son joli coda vocal qui renoue quelquefois avec le passé du groupe.
En guise de conclusion, l’ambitieux et narratif "The Last Resort", vaut plus par son propos désabusé (et déprimant) que par sa structure musicale très répétitive qui manque cruellement de reliefs, de développements et (parfois) de panache sur sept fort longues minutes.
Probablement un titre à écouter, après une rupture amoureuse, sur une cassette huit pistes en conduisant une "américaine" sur une autoroute déserte écrasée de soleil…
A condition d’avoir vraiment perdu tout espoir.
They call it paradise
I don't know why
You call someplace paradise
Kiss it goodbye (9)
Où est passé l’esprit des conquérants, des défricheurs de terres nouvelles, des chercheurs d’or, des jeunes musiciens ambitieux que Bernie Leadon mettait si joliment en musique ?
Il s’est perdu dans des vapeurs d’alcool, des lignes de coke, des shoots de substances diverses et des soirées sans fin où il est plus important de paraître que d’être vraiment. Les grands espaces qui faisaient rêver les pères fondateurs sont devenus des chambres étriquées aux fenêtres scellées, où des êtres désespérés cherchent vainement à sevrer (sauver) leur âme d’addictions devenues insupportables.
Tout ça pour ça…
Entre une plage titulaire qui évoque des vies humaines détruites par les plaisirs douloureux et une plage conclusive qui décrit une nation oubliée et une nature martyrisée par les ambitions industrielles, Hotel California entraîne l’auditeur dans un monde paumé, sans réel espoir de reconstruction ni de rédemption.
Sans solution.
Même la production lumineuse de l’excellent Bill Szymczyk ne peut que rétro-éclairer une grisaille généralisée qui efface les reliefs et les couleurs et qui fait frissonner les corps en manque. Puis qui donne juste envie de chialer...
So I called up the Captain, "Please bring me my wine"
He said, "We haven't had that spirit here since 1969" (10)
Et ça fait long quand on a soif...
Héritage
"Nous avons enregistré Hotel California puis chacun est parti de son côté..." Avares de mots, c’est tout ce que les musiciens déclareront plus tard.
Ce qui fait de cet album l’un des plus incompris et, probablement, l’un des plus surévalués de son siècle, c’est, à mon sens, le fait qu’il ne propose aucune espèce de solution et qu’il ne porte en lui strictement aucun message d’espoir.
Je ne pense pas que la juste militance puisse se contenter de critiquer sans construire. Question de point de vue.
Ceci dit, en 2026, les États-Unis se préparent à fêter (ou pas) un deux-cent cinquantième anniversaire fait de bile, de haine, de mensonges, d’exclusions et d’amertume.
Alors, me direz-vous, quelle aurait été l'utilité de laisser des messages d’espoir dans une capsule temporelle ?
Et ça, ça reste une foutue bonne question...
(1) La suite se résumera à deux albums quelconques à mourir, The Long Run (1977) et Long Road Out Of Eden (2007). Et à de lucrative tournées où les Eagles deviendront leur propre cover band.
(2) Styx n’est pas vraiment un groupe "sociétal" mais Dennis DeYoung ("Suite Madame Blue" ) et James Young ("Miss America") ont écrit des textes touchants qui interrogeaient également l’avenir de leur nation.
(3) Tout est dit dans la plage titulaire de leur fantastique album Mad.
(4) Hotel California a curieusement été enregistré en Floride, à l’autre bout du bout, puis mixé à New-York.
(5) Vous pouvez accomplir les formalités de départ quand vous voulez / Mais vous ne pourrez jamais vraiment partir…
(6) Bernie Leadon s’en ira plus tard jouer les magnifiques parties de guitare(s) sur "Osez Josephine" d’Alain Bashung. A réécouter !
(7) Tout est raconté dans la chronique de One Of These Nights qui peut être consultée par ailleurs sur AlbumRock.
(8) Le Son de Philadelphie était une évolution un peu mollassonne de la musique soul, apparue à la fin des sixties. Il se caractérisait par des arrangements assez somptueux (voire fort envahissants) de cordes et de cuivres.
(9) Ils ont appelé ça Paradis / Sans savoir pourquoi / Si tu appelles un lieu Paradis / Pense à lui dire adieu...
(10) Alors j’ai appelé le sommelier pour commander du vin / Il m’a dit "Nous ne servons plus ce genre d’alcool depuis 1969..."
Issue de la culture biologique (à 90 %) et de la pêche responsable, cette chronique AlbumRock, garantie sans sulfites, sans gluten ni sucres ajoutés, a été tapée, caractère après caractère, par deux vraies vieilles mains humaines sur un clavier en plastique recyclable fabriqué à vil prix en Chine.
Je remercie sincèrement les adorables lecteurs et lectrices qui corrigent mes textes et, tout particulièrement, la femme qui partage patiemment ma vie et mon brave chien qui m’observe d’un regard bienveillant quand je rédige toutes mes bêtises.