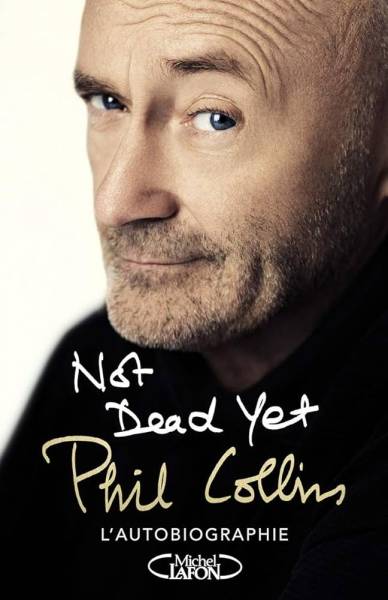Sleep Token
Even In Arcadia
Produit par Carl Brown
1- Look to Windward / 2- Emergence / 3- Past Self / 4- Dangerous / 5- Caramel / 6- Even in Arcadia / 7- Provider / 8- Damocles / 9- gethsemane / 10- Infinite Baths


La notion de genre en musique n’a plus le même sens ou le même poids aujourd’hui qu’elle n’en avait il y a une trentaine d’années. L’essor d’internet, la création du format mp3 puis les diverses transformations de l’industrie qui ont mené à la centralité actuelle des plateformes de streaming ont naturellement bouleversé notre manière d’approcher l’art du son. Puisque tout semble accessible en quelques clics, pourquoi attendre la sortie de notre magazine spécialisé ou de notre émission de radio favorite pour découvrir de nouveaux artistes ? Quelle est la limite de notre curiosité lorsque l’exploration d’un style que l’on apprécie peu au premier abord ne nécessite plus aucun engagement financier ? Certaines vieilles barrières culturelles se sont ainsi effacées avec l’avènement du piratage, avant de renaître sous une autre forme, imposée par les algorithmes rigides de Spotify et consorts.
Les webzines comme le nôtre sont en ce sens un rappel de ces anciennes manières de vivre la musique populaire, puisqu’ils témoignent d’un ancrage de moins en moins pertinent pour les mélomanes du XXIème siècle : les identités musicales sont devenues plus hybrides, moins contradictoires, et donc moins strictement attachées aux différents courants et à leurs cultures respectives. Il y a bien sûr des exceptions, ou en tout cas des résistances locales plus fortes que d’autres. La dimension communautaire du metal s’est ainsi révélée assez solide pour surmonter ces transformations technologiques sans grandes pertes. Une fermeté logique, nourrie par le sentiment de marginalité propre au genre et par un attachement à une mythologie étroite, peu sensible aux tendances extérieures – comme autant de remparts contre la banalité du quotidien. S’ajoutent à cela des logiques de distinction internes, entremêlées dans des idées de complexité, de technicité et même de pureté qu’on retrouve rarement ailleurs dans de telles proportions et qui instaurent alors une sorte de hiérarchie implicite au sein du mouvement.
Quelles conséquences cet entre-soi a-t-il sur le metal comme expression artistique ? Autant de passions extrêmes et d’élans créatifs que de blocages stériles. Le foisonnement infini de sous-genres qui en découle peut ressembler, pour le néophyte, à un banian géant au feuillage sinistre. Il s’accompagne cependant d’un élitisme pesant, qui traque sans relâche les prétendus opportunistes ou non-méritants — jusqu’à l’absurde parfois, comme lorsque la présence de rose pastel sur une pochette d’album devient un motif de sanction indépendamment du contenu. L’innovation n’est pas impossible mais souvent un peu plus lente qu’elle ne pourrait l’être lorsqu’elle passe par une ouverture au reste du monde musical. En particulier, la plupart des projets ayant essayé de faire coïncider le metal avec d’autres univers sonores plus accessibles se sont alors souvent retrouvés dans un entre-deux plutôt désagréable, puisque trop "metal" pour être compris par les médias généralistes, et pas assez pour être pris au sérieux par les autres : il faut dire que lorsque l’on tient à se maintenir "hors du système", tout rapprochement — volontaire ou non — vers quelque chose de plus commercial peut être vécu comme une trahison.
Ces réticences n’ont pas empêché les artistes évoluant dans cet espace intermédiaire de développer un public important. Pendant les années 90, la fusion funk-metal puis le neo-metal ont progressivement creusé une brèche. Elle a permis à des groupes comme Limp Bizkit, Evanescence ou Linkin Park d’atteindre des chiffres de ventes monumentaux en élargissant ou simplifiant le mélange des genres, tout en traumatisant la presse metal au passage – au-delà de quelques exceptions comme System Of A Down ou Deftones. Le metalcore a suivi en reprenant, dans une moindre mesure, ce rôle de pont entre la pop mainstream et le metal avec des groupes comme Bullet For My Valentine, A Day To Remember, Avenged Sevenfold et Bring Me The Horizon. Mais l’heure de gloire de la plupart de ces formations paraît désormais bien lointaine : on parle désormais plutôt de Spiritbox, Bad Omens, Falling in Reverse et Sleep Token. Il n’existe pas de genre clairement défini pour qualifier cette nouvelle génération (on évoque parfois la dark pop, le pop metal, ou l’alt pop), car ces groupes ne se ressemblent que par leur éloignement vis à vis des normes historiques du metal, tout en plaçant celui-ci au centre de leur univers musical et en restant accessible pour le grand public.
Sleep Token évolue depuis quatre disques sous l'anonymat des masques à la manière de Slipknot et surtout de Ghost. Pendant l’une des rares interviews données par le groupe anglais, le frontman (qui se présente sous le nom de "Vessel") s’est exprimé sur leur éclectisme stylistique : "Life is dark. Life is bright. Life is ugly. Life is beautiful. Don’t get lost in genres, they’ll only disorientate you. Music is for everyone." Au-delà de la lourdeur du propos, il apparaît évident que le groupe rejette, au moins publiquement, l’héritage spécifique d’un ou plusieurs genres ainsi que les anciennes logiques de fusion issues du metal. Et cela semble presque cohérent, du moins en surface, lorsque l’on constate que Sleep Token a facilement atteint la première place du Billboard américain et des charts anglais avec leur dernier album. Celui-ci mêle, dans un désordre revendiqué : R&B, rap, djent, reggae, trap, post-metal, electronic dance music, metalcore… Est-ce qu’un groupe a déjà été aussi loin dans le mélange, tout en ayant un pied dans le metal et une présentation résolument grand public ? Si l’on écarte le tristement célèbre A Thousand Suns qui est loin d’être le plus grand succès critique et commercial de Linkin Park, probablement pas. Est-ce pour autant une excuse pour se moquer du monde comme le fait Sleep Token sur ce Even In Arcadia ?
Prenons "Caramel", l’un des trois extraits dévoilés avant la sortie du projet. Le titre débute comme une version dépressive de "Shape of You" d’Ed Sheeran et s’achève dans un climax blackgaze façon Deafheaven, fréquemment interrompu par ce qui pourrait être le chanteur d’Imagine Dragons. La comparaison paraît absurde mais elle n’a malheureusement rien d'exagéré : les couplets reposent sur les mêmes percussions et rythmiques jamaïcaines gentrifiées que le tube de Sheeran, tandis que la dernière section mêle des schrieks black metal, des couches épaisses de trémolos et un chant clair surjoué et larmoyant, qui dissipe toute forme de tension. Entre ces deux extrêmes, il faut endurer une tentative de rap très anecdotique, quelques power chords si effacées dans le mix qu’on les croirait enregistrées dans le studio d’à côté et un jumpscare poussiéreux sous forme d’un breakdown metalcore. "Caramel" évoque dans le texte la souffrance des membres du groupe face aux diverses intrusions de leur public dans leurs vies privées — certains étant même allés jusqu’à les pirater pour découvrir leur véritable identité. Le sujet n’est abordé que vaguement, superficiellement, ou au travers d’images fatiguées ("Stick to me, stick to me like caramel / Walk besides me till you feel nothing as well"), mais il est également difficile de sympathiser avec ce sentiment lorsqu’il est accompagné de sonorités et d’ambiances aussi hétérogènes, annihilant le peu de cohérence émotionnelle d’un titre qui se veut pourtant grave et sérieux.
Pour avoir un produit final commercialement viable, le dénominateur commun de tous les styles évoqués sur cet album ne peut être que la médiocrité ou l'inoffensivité. Even in Arcadia défend une pop mélodramatique faussement aventureuse, sans texture et sans âme ("Past Self", "Infinite Baths"). Il est en plus de ça parasité par des fantaisies stylistiques artificielles, à commencer par le metal, globalement relayé au rang de gimmick sur ce projet. On compte par exemple moins de 15 minutes de guitares lourdes sur tout l’album qui en fait 56, et il s’agit majoritairement de sections instrumentales très courtes ou de power chords en arrière-plan d’un refrain. Les rares hurlements sont souvent éphémères ou ensevelis sous la distorsion, et on peine donc à trouver quoi que ce soit d’impressionnant dans la dimension “extrême” de leur musique. Ce constat vaut aussi pour le reste : la plupart des éléments électroniques manquent de corps ou de personnalité, quand ils ne sont pas tout simplement d’une qualité amatrice (l’arpégiateur de "Emergence", le lead de "Provider"). Les performances rap ennuient par leur manque de technique et de variété ("Past Self", "Gethsemane"). Le chant cursif de Vessel, dont le timbre se situe entre ceux de Dan Reynolds et Benjamin Burnley de Breaking Benjamin, invoque le pire du R&B moderne et transforme chaque syllabe en enclume ("Look To Windward", "Damocles"). Si tout est lourd et grave, rien ne l’est vraiment, d’autant plus que les textes ne sont faits que de métaphores et d’hyperboles transparentes qui peuvent dire tout et leur contraire, comme de l’art abstrait pensé par des communicants. Et que dire de l’outro jazzy de "Permanence" avec son caprice inutile de saxophone, ou des effets vocaux insupportables dispersés un peu partout…
Lorsque l’on voit à quelle vitesse Sleep Token passe d’un genre à l’autre dans un seul et même titre sans se soucier du sens, on comprend mieux ce que Vessel signifie vraiment lorsqu’il déclare "Don’t get lost in genres, they’ll only disorientate you". Le genre en musique, au-delà de l’aspect culturel décrit en introduction, constitue surtout une clé de compréhension historique et un outil de comparaison. Cultiver un intérêt pour plusieurs artistes qui partagent des influences et des savoir-faire communs permet de découvrir de nouveaux mondes dans lesquels nous avons notre place : existe-t-il des moments plus précieux que ceux-là dans la vie d’un mélomane ? Le genre n’est pas lui-même une feuille de route, un cahier des charges ou une prison. Cela peut l’être d’un point de vue médiatique, lorsque des publications refusent de faire évoluer leur catégorisation au fil des années, mais cela reste un questionnement qui relève du marketing et non du processus créatif. Idéalement, le genre doit être, pour un artiste aujourd’hui, "un outil flexible et provisoire, suffisamment souple et ouvert pour créer les conditions de son renouvellement"¹. Si le genre est sincèrement synonyme de tromperie et d’exclusion pour Sleep Token, alors le groupe en dénature complètement la fonction.
Le patchwork présenté par Even In Arcadia confirme malheureusement une juxtaposition de couleurs forcée, irrationnelle et presque maladive, qui fait rapidement disparaître toute émotion ou nuance chromatique. Il n’y a alors aucun titre de ce nouvel album que l’on peut apprécier du début jusqu’à la fin – malgré les efforts du batteur surnommé "II" qui sauve presque certains titres de leur indigence, avec un jeu puissant, précis mais généreux rappelant Abe Cunnigham de Deftones. Le problème ne réside pas dans l’idée d’accomplir ces associations musicales risquées, mais dans le manque de maîtrise et d’intention derrière elles, et il s’agit du premier élément de leur discographie où ces lacunes se montrent aussi alarmantes. À vrai dire, l’intention du groupe reste difficile à saisir. Est-ce que le désastre esthétique permanent au cœur de leur art est le résultat d’une peur sincère d’être enfermé dans des catégories qui ne leur correspondent pas, ou s’agit-il d’une stratégie de distinction réfléchie ? La communication du groupe semble ne rien laisser au hasard, et la plupart des fans du projet ont l’air au moins autant investis dans l’imaginaire déployé par le groupe que dans le reste. L’abstraction, alignée sur un ton mélodramatique, apparaît comme une outil facile pour établir une connexion forte avec un public, puisqu’il peut y projeter ce qu’il veut, en particulier les émotions les plus lourdes. D’une certaine manière, l’aura de mystère qui entoure leur anonymat, leur univers et leurs textes se voit renforcée par le caractère imprévisible de leurs créations, même s’il n’a rien d’organique. Tout ce décorum implique que la musique est plus profonde qu’elle n’en a l’air, et la musique elle-même déborde de prétentions avec ses structures "progressives" interminables, complexes, mais vaines.
Présenté comme ceci, Sleep Token ressemble à une farce d’étudiants en marketing qui auraient vu dans le cloisonnement et la fibre mythologique du metal une aubaine commerciale. Le résultat est difficile à encaisser : une sorte de macronisme musical – ni metal, ni pop, mais donc quand même très pop et dans tous les cas très mauvais. Notre optimisme nous force malgré tout à penser que les deux musiciens derrière le groupe sont surtout naïfs et en manque de repères créatifs, que leur succès tient davantage à la densité de leur imaginaire et à un espace médiatique vacant qu’à une créativité sacrifiée pour une ambition mercantile. A moins que cela ne soit une conséquence accidentelle des transformations et des tensions décrites en introduction, soit la posture désormais singulière du metal dans un monde où les identités musicales se sont fractionnées. L’erreur dramatique de Sleep Token est d’avoir pensé qu’il était possible d’expérimenter sérieusement sans s’aliéner une majorité d’auditeurs, et cette illusion ne tient probablement que par le fait qu’une majorité de fans de metal n’écoutent pas grand chose d’autre, et inversement. Enfin, pour celles et ceux qui pensent que le succès d’un groupe comme celui-ci est positif en ce qu’il apporterait le metal à de nouvelles oreilles : c’est en effet une possibilité et nous ne défendrons pas l'isolement du genre à tout prix – au contraire. Mais quelle conception de l’art et de la musique véhicule véritablement un disque comme Even In Arcadia ? Ouvre-t-il vraiment des portes, ou finit-il par en fermer davantage ?
A écouter : Le doux silence entre les titres
¹ Hard Rock, Heavy Metal, Metal. Histoire, culture et pratiquants. Fabien Hein – Mélanie Séteun/irma, Nantes/Paris, 2003