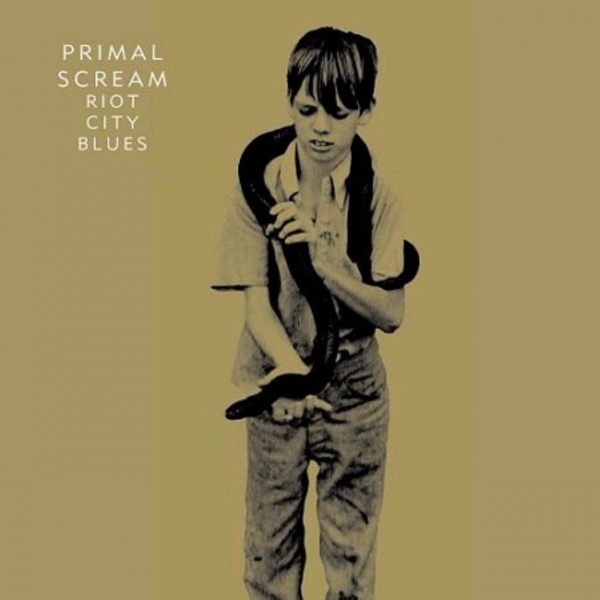Primal Scream
Screamadelica
Produit par
1- Movin' on Up / 2- Slip Inside This House / 3- Don't Fight It, Feel It / 4- Higher Than The Sun / 5- Inner Flight / 6- Come Together (Terry Farley mix) / 7- Loaded / 8- Damaged / 9- I'm Comin' Down / 10- Higher Than the Sun (A Dub Symphony in Two Parts) / 11- Shine Like Stars


Comment réinjecter un peu de fraicheur et d'excitation à cette vieille chose qu'est devenue le rock ? Voici le grand problème auquel s'attèlera une foultitude de groupes à l'orée des années 90, après une décennie qui l'avait vu s'empâter dans les stades et perdre progressivement son pouvoir d'attraction. Les réponses fusèrent, le repli élitiste prôné par la scène alternative, l'option dépressive du grunge ou encore la tentation vampiriste qui consiste à se parer des oripeaux de la nouveauté portée par des musiques émergentes (hip-hop, techno) pour redonner au binaire une seconde jeunesse. Une telle entreprise nécessite du flair, un poil d'opportunisme et pas mal de chance. A l'époque, il manquait encore un album phare pour défendre la cause devant la multitude. Bizarrement, le cadeau échut à Primal Scream.
Le gang écossais semblait en effet à mille lieues de convenir à la fiche de poste. Bobby Gillespie, tout d'abord, est un chanteur médiocre disposant du charisme d'une tanche à demi morte. Rien ne destinait, sur le papier, l'ancien batteur des Jesus And Mary Chain au rôle de galvaniseur de foules extatiques. Surtout, Primal Scream a jusqu'ici aligné deux albums bâtis sur la sainte trinité Byrds/Velvet/Love, incarnant le prototype même du groupe qu'on ne voulait plus voir et entendre en Angleterre, alors que le pays sombrait corps et biens dans le bain technoïde déversé par la house de Detroit. Leurs disques se font littéralement exécuter par la presse et leurs misérables tournées les conduisent à se produire devant les salles à moitié vides des bouges de l'archipel. 1989 s'achève piteusement, le spectre du chômage rôde. La troupe, complètement démoralisée, s'exile à Brighton pour profiter de ses loyers modérés. Alan McGee, célèbre patron du label Creation et ami de longue date de Gillespie, fait régulièrement la navette depuis Manchester pour venir rompre leur déprime quotidienne. Là-bas, Happy Mondays, New Order et Stone Roses lancent depuis les profondeurs de l'Haçienda une nouba non stop dopée aux substances chimiques et aux murs de son électroniques. McGee ne jure plus que par la house music, et ne manque pas de rapporter des maxis à chacun de ses voyages. Qui laissent les musiciens de marbre. La déclic viendra d'autres produits que le lascar emporte dans ses bagages, ces petites pilules colorées qu'on nomme ecstasy. Dans le cerveau embrumé de Gillespie, cette drogue inédite fait l'effet d'une déflagration cosmique. Tout devient à nouveau frais, excitant, passionnant, fantastique. Les lettres MDMA forment un sésame inespéré, une promesse de reprendre les choses là où elles s'étaient arrêtées à la fin du Summer Of Love.
Alan McGee croît dur comme au fer au potentiel du Scream. Ne manque que l'étincelle pour tout embraser. Depuis des mois, le rouquin mène une intense campagne de lobbying auprès du NME, les harcelant sans relâche, les priant de se porter au chevet de ses protégés. De guerre lasse, l'hebdomadaire cède et dépêche Andrew Weatherall. Maçon de son état, Weatherall édite son propre fanzine (Boy's Own), officie en tant que DJ et s'est lancé depuis quelques mois dans la production. Les gars s'entendent rapidement comme larrons en foire. Entre deux prises de cachetons, les musiciens proposent à Weatherall de remixer un de leurs morceaux. Son choix se porte alors sur l'une des pistes de l'album éponyme, l'alangui "I'm Losing More Than I'll Ever Have". Mais les plusieurs ébauches qu'il présente ne satisfont pas le groupe. Gillespie lui propose finalement de sampler un monologue de Peter Fonda tiré de Wild Angels (film de bikers des années 60 réalisé par Roger Corman). Le journaliste s'exécute, tranche dans le vif de la chanson originale pour n'en conserver que le final. La troisième tentative est la bonne. Ainsi nait "Loaded".
"We want to be free to do what we want to do, we want to get loaded, and we want to have a good time." Le morceau contient déjà toutes les bases du futur projet Screamadelica. Samples en forme d'exhortations dionysiaques, rythme chaloupé, choeurs gospel, cuivres tonnants, l'armada festive se met en branle. Sorti en février 1990, le single cartonne, s'écoulant à 100 000 exemplaires, et la côte de Primal Scream grimpe en flèche. La confiance revenue, le groupe investit ses royalties dans la confection d'un studio de fortune basé à quelques encablures des bureaux de Creation. Sampler, ordinateur, claviers et micros s'entassent dans le petit local. La troupe a la bénédiction de McGee, mais pas un accès illimité à son porte-monnaie. La gestation houleuse du Loveless de My Bloody Valentine a plongé les comptes du label dans le rouge, aussi est-il convenu d'un emploi du temps strict, les musiciens travaillant du mardi au vendredi, se laissant le week-end pour se défoncer et le lundi pour récupérer. Sur cette lancée déboule rapidement "Come Together", renchérissant sur la formule édictée par "Loaded". Un speech de Jesse Jackson instaure la musique comme force libératrice, s'ensuit une débauche de plus de 10 minutes dans sa version originale où s'empilent orgue diluvien, bleeps acides, une jungle de percussions et une envolée chorale martelant cet unique credo : "Come together as one". Primal Scream y réinvente le "Sympathy For The Devil" de l'ère techno, le rythme y est tout aussi obsédant, mais plus marqué sur son reboot. Le morceau appelle également à une longue transe, les bras grand ouverts, non pour accueillir Lucifer, mais pour cette fois s'imprégner de l'ivresse collective des grands rassemblements estivaux, promesse avortée d'un nouveau Woodstock. Le groupe est clairement à la recherche d'une vibration à même de connecter la planète des rockeurs fatigués avec la pulsation lysergique sur laquelle se sont calées les foules technoïdes. Le quartette n'est pas loin d'atteindre son objectif, un peuple de plus en plus vaste se range derrière l'appel de "Come Together" tout au long de l'été 1990.
La sortie de l'album se profile pour la rentrée 1991, laissant le groupe et son management le temps de faire soigneusement monter la température du côté de la presse musicale. Par pur snobisme, le collectif sort "Higher Than The Sun" en single, histoire de revendiquer la haute teneur expérimentale de son dance-rock. Alan McGee, jamais avare d'une énormité pour survendre la tambouille maison, le qualifie de "morceau le plus révolutionnaire depuis Anarchy In The UK". Pourtant, c'est plutôt PiL que Gillespie et ses potes viennent piller (Jah Wobble prête sa basse hypnotique sur les deux versions du titre), ébauchant une mélopée proto-dub serpentante et paranoïaque, foncièrement plus malsaine que le contenu plus hédoniste des précédents hits. Le fruit de la hype étant suffisamment mûr, Screamadelica déboule le 23 septembre comme le messie et se voit élevé quasiment le jour même de sa sortie au rang d'album électro-rock définitif, unanimement salué pour le caractère visionnaire de sa production. Le smiley détourné façon buvard de LSD de la pochette devient rapidement l'emblème du rock dopé à l'ecstasy, aventureux, festif, grisant, capable pour la première fois de damer le pion à l'électro sur son propre terrain, celui des sound systems pharaoniques et des remixes débités au kilomètre. L'album a surtout le bon goût de tomber au bon moment, bénéficiant des précédents coups de boutoirs des Happy Mondays et des Stone Roses de "Fools Gold" et "One Love" pour synthétiser à lui seul une époque, une utopie. Il justifie en tout cas son statut culte par son impact tellurique sur le futur paysage musical du royaume. Il présidera les nombreuses noces entre rock et électro qui se tiendront tout au long de la décennie, incitera Fatboy Slim à transformer Brighton en nouvelle Ibiza, décidera Liam Howlett à injecter riffs de guitare et beuglements rotteniens dans les circuits de son Prodigy, poussera les très orthodoxes frangins Gallagher à délaisser pour un temps leurs vinyles poussiéreux pour aller s'acoquiner avec les Chemical Brothers et Death In Vegas. La nu-rave des Klaxons/Late Of The Pier ne cherche-t-elle pas à relancer les bacchanales là où Primal Scream les avaient arrêtées ?
Si l'on n'en finit pas de relever les preuves de la postérité de ce troisième effort, rien ne nous empêche, avec le recul confortable de deux décennies, de questionner son statut iconique. Au jeu de l'écoute patiente, Screamadelica se révèle être le prototype même du disque électronique rêvé par des rockeurs, plutôt qu'une fusion (terme très à la mode à cette époque) franche entre ces deux univers. Les Primal Scream sont des petits malins, et accomplissent avec leur manifeste un joli tour de passe-passe. Derrière sa forêt de samples, il ne reste rien d'autre qu'un album psychédélique dans la droite lignée de ses deux prédécesseurs, avec son lot de litanies trippantes, ses instants de grâce, ses moments de flottements. Les pédales fuzz ont juste cédé la place aux claviers. Le groupe s'est en réalité dissout dans le concept de son disque. On entend à peine les guitares, quand le chant de Bobby Gillespie s'est raréfié, ce dernier se bornant à endosser le costume de MC sur la plupart des plages. Screamadelica constitue le rêve éperdu de hippies tardifs, conçu dans la rancoeur d'être arrivé des décennies trop tard, après la grande fête, singeant la comédie du renouveau pour rejouer la scène primitive de 1967. Aussi n'est-on pas surpris d'apprendre qu'au milieu de la cohorte de producteurs qui se sont relayés derrière la console de son (cinq au total) figure le nom de Jimmy Miller, celui-là même qui aida les Rolling Stones à sublimer leurs grandes oeuvres de la fin des années 60 et du début des années 70. C'est sous son patronage que l'opus s'ouvre sur "Movin' On Up", et l'on comprend dès lors où les Ecossais sont allés puisés leurs choeurs, plutôt du côté de "Gimme Shelter" que d'Afrika Bambaataa. L'ombre de "Sympathy For The Devil" plane à nouveau sur le titre. Et pour cause, il invite à la même ripaille que celle de Beggars Banquet, les pintades farcies à l'héro et les faisans saupoudrés de coke laissant place aux coupes pleines de gélules multicolores. Règne une identique morgue placide, presque laid-back. Elle ne se confond plus avec la suffisance repue du rockeur qui sent la révolution approcher ("Street Fighting Man"), elle prend les traits d'un optimisme béat devant la perspective d'une nouba universelle. A l'échelle stonienne, Screamadelica investit ainsi un espace fantasmagorique, cette béance séparant deux albums apparemment éloignés dans leur projet, quelque part entre la tentation psyché de Their Satanic Majesties Request et le repli sur les racines rock prôné par Beggars Banquet. D'un côté la soif d'expériences inédites, de l'autre le désir de ne pas déroger à la tradition.
Le groupe clarifie encore ses intentions sur la piste suivante ("Slip Inside This House"), reprise du 13th Floor Elevator au cours de laquelle Gillespie s'agonise dans un maelström de sitars kaléidoscopiques pour en décupler l'impact hallucinogène initial. Screamadelica n'est que la continuation d'un projet consubstantiel au rock (faire se déhancher les foules, se connecter à l'esprit des gens pour en contrôler les modulations, grand crédo psyché) par d'autres moyens. Où comment un Atari ST équipé de connections MIDI peut se substituer à une cruche électrifiée. Comme les pionniers, Primal Scream dévalise les fondamentaux de la musique noire (choeurs gospel, une obsession pour les percussions qui parcours la quasi intégralité de l'ensemble) pour se les réapproprier et les arranger selon de nouveaux paramètres. Voilà pourquoi un auditeur pensant tomber sur une machine à danser de 65 minutes risquerait d'en sortir déçu, et de trouver tout cela bien mou. Rivé sur ses piliers psychédéliques, le disque n'autorise que le mouvement débraillé, la guinche approximative. Il ne s'est pas totalement résolu à se faire cadencer par une machine, oppose le rythme obsédant à la scansion des BPM, privilégie les plaines herbeuses aux dancefloors. D'ailleurs, quand il consent pour un temps à passer le tempo sous une coupe exclusivement électronique, c'est pour usiner un "Don't Fight It, Feel It" qui a bien mal vieilli, avec sa jungle funkoïde croassante et ses claviers périmés. Ce psychédélisme ravaudé a cependant tiré un trait sur toute la dimension politique et spirituelle que le genre prétendait originellement porter. Ici plus question de faire évoluer les mentalités, de déciller les yeux du profane pour l'ouvrir à des potentialités inédites. Seul règne désormais le soliloque du corps, l'esprit définitivement débranché. En lieu et place est proposé une communion universelle apolitique, le culte du moment présent. En un sens, Screamadelica entérine la mort du projet originel, le psychédélisme ne devenant plus un moyen mais sa propre fin. En cela, Primal Scream s'improvise comme parrain lointain de MGMT.
La grande question d'un disque-trip reste de savoir comment il gère ses temps faibles. Autrement dit, Screamadelica tient-il sur la longueur ? Pas tellement. Une fois les grands tubes passés, l'album s'essouffle dans sa dernière partie. "Damaged" est une pénible balade geignarde, Primal Scream foirant l'exercice une fois sur deux, quant aux autres morceaux, plus introspectifs ("Inner Flight", "I'm Coming Down"), ils n'ont d'autre but que d'apporter un peu de respiration à l'ensemble, comme des petites pauses chill-out entre deux embardées festives. S'ils pouvaient autrefois intriguer par leur production inventive, ils s'avèrent aujourd'hui bien anecdotiques. C'est bien le problème des disques salués comme modernes à leur sortie, bien souvent ils sonnent datés cinq ans plus tard, vieille antienne critique qui se vérifie cruellement ici. Si la génération qui s'est pris le disque en pleine poire (et qui accuse la trentaine bien sonnée aujourd'hui) le célèbre avec déférence pour son 20ème anniversaire, on ne peut s'empêcher de se demander quel accueil lui réserveront les jeunes mélomanes actuels. Que reste-t-il de l'expérience Screamadelica à l'heure où le mp3 impose un équarrissage impitoyable ? Un instantané de l'époque et quelques singles mémorables. C'est peu et beaucoup à la fois.
Primal Scream lui-même n'a pas capitalisé longtemps sur son chef-d'oeuvre. Au même moment sort Nevermind, stoppant brutalement des festivités qui ne reprendront que lorsque déboulera le Big Beat. Gillespie et ses potes, eux, sont déjà passés à autre chose, singeant les Stones comme ils savent si bien le faire avec le brillant Give Out But Don't Give Up. La parenthèse Screamadelica ne sera pas refermée pour autant, le groupe ressortant les samplers un album sur deux. Avec le recul, on peut même constater que Vanishing Point (1997) et XTRMNTR (2000) tiennent mieux la route que leur grand frère. Ils s'avèrent plus homogènes, plus rigoureux, d'une qualité plus constante, parce que l'un saute enfin à pieds joints dans le bain électro sans se sentir obligé de donner du change au rock, quand l'autre s'appuie sur les cordes séculières du krautrock. Seulement, même dans leurs meilleurs moments, ils ne parviennent pas à retrouver le charme de cet album matriciel. Même si son prestige s'est un peu flétri et que sa dimension avant-gardiste apparaît désormais quelque peu exagérée, l'opus reste une bouffée d'euphorie extatique, il irradie d'insouciance solaire, il demeure un puissant déshinibiteur. Pour que la planète rock tourne rond, sans doute faudrait-il qu'un Screamadelica sorte tous les 10 ans.