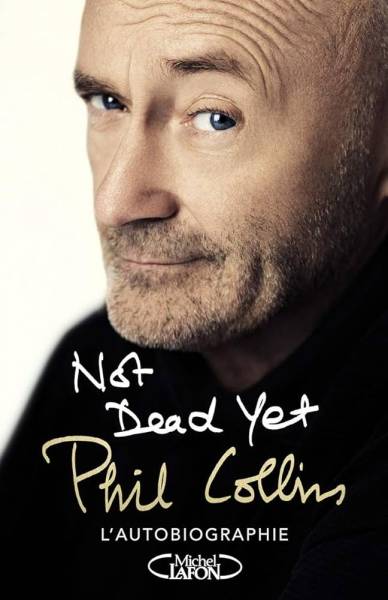Discorama 2000's : les incontournables art rock
2009

Janvier 2009
Quand on exhibe une pochette à l'illusion d'optique probante, il est presque normal que l'on présente un album qui sort de l'ordinaire et du pré-fabriqué musical. La mélodie bateau qui ne déborde pas de ses pointillés, mais qui séduit les plus fainéants, n'est pas du ressort d'Animal Collective. Les huit albums précédents ont prédécoupé l'univers du groupe avec dextérité, un univers déroutant, électro et débordant. Ce neuvième opus est un condensé des meilleurs parts gravées sur ses prédécesseurs, rien dans l'extrême, tout dans la finesse et l'apesanteur sauvage.
Après être resté 15 minutes devant la pochette, en bougeant les yeux de gauche à droite et de haut en bas, le sourire béat et frôlant la convulsion, on se brûle les doigts et on lance la galette. Animal Collective : groupe psyché, qu'on se le dise. Les plus réticents face au rock expérimental font la grimace, et pourtant, ils peuvent trouver leur compte dans Merriweather Post Pavilion, puisque ce dernier rebondit et fusionne avec une trame pop-rock. Prenons ''My girls'' par exemple : si l'on supprime le premier tissage fait de claviers hypnotisant, on se retrouve face à un morceau pop au son parfait. Une fois cette feinte trouvée, la touche psyché n'en est que plus appréciable, essayez donc avec ''Summertime Clothes''. De petits jaillissements à petites explosions, le quatuor bouillonne pour offrir un opus psychédéliquement frais.
Écouter Animal Collective est une vraie distorsion de méninges, vu que chaque titre part sur une pente instrumentale particulière mais dont la direction est similaire : la catalepsie. Cerveau embué, on avance à l'aveuglette dans un tourbillon rythmé, comme peuvent l'attester ''In the flowers'', où des bulles d'acier font place à une rythmique redondante, ou encore ''Taste'', qui saute comme de l'huile sur le feu. La superposition des voix et des instruments donne cette impression de rêve au ralenti, voire de demi démence onirique (''Guys Eyes''). Comme une aquarelle qui prend l'eau pour en donner un résultat étrangement plaisant, Merriweather Post Pavilion plait et laisse une trace dans les sorties atypiques de 2009. Étonnamment et après mûre analyse, on remarque que sous ce flou général, chaque morceau est adroitement travaillé et ciselé. Plus de précision pour un fouillis plus maitrisé, l'expérience est validée. Sont forts ces petits gars du Maryland.
Emilie

Mars 2009
C'est un fait indiscutable : dans les années 2000, comme d'ailleurs dans les années 80 et 90, le terme "progressif" a été considéré comme un gros mot. Une faute de goût impardonnable, une profession de foi tout aussi vulgaire qu'intellectualisante, une qualification passéiste qui ne trouve plus aucun sens dans notre monde moderne. C'en est arrivé à un tel point que les critiques rock, de quelque bord qu'ils soient, n'ont plus daigné s'intéresser au moindre groupe lorgnant vers une filiation progressive depuis une sacrée paye. Mais il y en a quand même un qui est parvenu à taper gentiment dans l'œil du NME, et ça, compte tenu de l'état d'esprit précédemment décrit, ça n'est pas rien. Oh, rassurez-vous, rien d'extravagant : pas de photo en une, pas d'interviews racoleuses sur huit pages, pas de live reports vibrants d'intensité. Non, juste quelques critiques publiées (ce qui est déjà bien) et même flatteuses (ce qui est encore mieux). Mais peut-on encore affirmer que Pure Reason Revolution est un groupe progressif ? Probablement pas, et c'est bien là tout le fond du problème.
L'affaire qui nous occupe ici commence de la façon la plus banale qui soit. Six garçons et filles, étudiants à l'université de Westminster, férus de littérature, d'art plastique et de musique, se mettent en tête de former un groupe de rock en vue de toucher avant tout à une esthétique novatrice. Leur idée est toute bête : marier les grandes œuvres progressives des cadors du genre (Pink Floyd, Porcupine Tree) à des sonorités synthétiques plus modernes, louchant aussi bien du côté de Kraftwerk que de Daft Punk. En 2006 sort le premier album de la "Révolution de la Raison Pure" (nom bien sûr emprunté à Kant), et là c'est le choc. The Dark Third, signé sur une major (Sony BMG), met la totalité du milieu progressif en émoi en réalisant un hommage presque obsessionnel au Floyd (on peut y retrouver notamment des sonorités qu'on jurerait décalquées de Meddle et de Wish You Were Here) tout en y instillant des éléments très personnels : guitares tantôt cristallines, tantôt distordues et massacrantes (avec quelques piques metal assez bluffantes), synthétiseurs galactiques reprenant la filiation moderniste de Richard Wright, constructions héroïques parfaitement emboitées et chant dual masculin-féminin d'une rare beauté. L'album se décline en plusieurs éditions et se voit avantageusement complété par l'EP sorti quelques mois avant (Cautionnary Tales For The Brave) pour culminer à plus de 1h30 de rock progressif comme on n'en avait plus vu depuis bien longtemps - productions de Steven Wilson mises à part. Soyons clair, Albumrock ne consacrera pas de dossier sur les incontournables du rock progressif dans les années 2000, le genre restant bien sûr trop confidentiel pour intéresser le public tout venant. Pour autant, s'il y a bien un disque à retenir dans cette mouvance, et à l'exclusion de toutes les productions metal prog qui, elles, rencontrent actuellement un certain succès, c'est bien ce disque qui demeure encore à ce jour parfaitement phénoménal.
Bref, revenons à nos moutons. Réaliser un bon disque n'est pas forcément synonyme de succès dans les bacs, cela va sans dire, et la réalité est bien cruelle pour les PRR qui, faute de ventes suffisamment affriolantes pour Sony (label qui avait pourtant pris de sacrés risques en signant un groupe d'ascendance prog), se fait rapidement prier d'aller voir ailleurs. Fatalement, la formation se déchire et le frère du frontman John Courtney, Andrew, décide de voguer vers d'autres horizons, emmenant dans son sillage le claviériste Jim Dobson. Réduit à quatre, le groupe prend le parti d'explorer encore plus avant ses velléités art-rock et expérimente sur scène de curieux OVNI où les guitares lourdes se mêlent à des samples électros ultra tendance. Pas effrayé pour un sou, le label allemand Superball flaire le potentiel du quatuor et le signe l'année suivante, réalisant en cela la première d'une longue série de coups fumants dans le milieu progressif, l'écurie montante ayant ensuite débauché successivement les regrettés Oceansize (RIP) mais aussi The Butterfly Effect et les talentueux dredg - entre autres. Début 2008, les amateurs déjà nombreux de la formation ont la surprise de voir débouler dans les bacs un album radicalement différent du premier. Amor Vincit Omnia est un disque complètement à part au sein de la scène rock anglaise : l'objet inaugure un genre difficilement classable que l'on pourrait benoîtement qualifier d' "électro-prog". Sans renoncer à certaines de leurs qualités (notamment vocales, le duo Jon Courtney - Chloe Alper se révélant toujours d'un magnétisme stupéfiant), les PRR ont cessé de regarder en arrière et se sont mis en tête de découvrir un style qui leur est propre et qui doit immanquablement passer par l'électro. Ce gadget synthétique est ici décliné à toutes les sauces, revisitant allègrement l'eurodance en mode mélancolique ("The Gloaming" faisant un net appel du pied à Ace Of Base) ou même le robotisme acidulé des Daft Punk ("Disconnect", franchement étrange), mais sans pour autant enthousiasmer follement. Par contre, AVO se révèle autrement plus jouissif dès lors que les guitares se mettent dans la partie, et l'on se retrouve alors avec de grands morceaux pop gonflés de samples rageurs et de six cordes gloutonnes qui emportent des titres comme "Les Malheurs" ou "Deus Ex Machina" vers des sommets d'obsession sonique. Ces deux titres, tout comme le percutant "Victorious Cupid" et le triptyque "i)Keep Me Sane/Insane ii) Apogee iii) Requiem For The Lovers" (ici nettement plus alambiqué et progressif), nous montrent un parti pris musical aussi radical que brillant qui fait illico de cet album un objet étrange, éclaté dans sa vocation de laboratoire expérimental, soufflant le feu et la glace sans discontinuer, mais faisant preuve de promesses diablement intéressantes en terme d'évolution musicale. Pure Reason Revolution a fait sa mue électro, et sa nouvelle couleur, quoiqu'encore indéterminée de façon formelle, semble lui aller à ravir.
Sauf que toutes les belles séries ont une fin. Si Hammer and Anvil, troisième album du combo de Westminster, a plus ou moins satisfait les critiques (et notamment le NME, retour au point de départ), c'est en éliminant ce qui pouvait effrayer dans cette débauche d'effets sonores baroques et chatoyants pour ne laisser subsister qu'une pop électro certes très bien troussée, mais bien trop timide malgré quelques lubies sonores intéressantes. Reste aux PRR à se recentrer sur leurs acquis et à s'appuyer sur leurs superbes prestations live (les rares français à avoir vu le groupe sur scène peuvent en témoigner) pour élever leur musique à un stade supérieur. Ils en sont capables, et l'art rock dans son ensemble pourrait ne pas s'en remettre.
Nicolas
lire la chronique de l'album

Juin 2009
Quel groupe anachronique. En 2004, alors que toute la planète rock s'excite sur un revival qui ne va pas tarder à tourner en rond, bloqué qu'il est sur ses références 60's et 70's (The Stooges, Velvet Underground, The Clash...), voilà que Kasabian sort son premier album et réactive... les raves. Après avoir proclamé la mort de l'hégémonie techno, les critiques rock se retrouvent à encenser un groupe qui se réclame de cette mouvance avec une musique qui ne s'adresse certainement pas au cerveau de l'auditeur. Le fan de rock anglais pouvait considérer que les Libertines c'était bon pour les minettes de 14 ans, avec Kasabian il trouvait enfin une formation dont il pouvait reprendre les refrains en chœur au pub et au stade ("Club Foot"). Le deuxième album reprenait ces bases et la musique allait en se complexifiant mais n'était toujours pas à la hauteur de la réjouissante arrogance dont faisait preuve le groupe en interview.
Arrive alors West Ryder Pauper Lunatic Asylum. La pochette annonce la couleur : mégalomanie. Le groupe fringué à la mode napoléonienne, le titre à rallonge, tout y est. Et la vulgarité en plus, car West Ryder... est un album un peu vulgaire parsemé de taches de mauvais goût. Celui-ci s'exprime par l'utilisation de nombreux clichés musicaux tels que l'écho, les bandes inversées et tout l'attirail des procédés qui "font psychédélique". Dès "Where Did All The Love Go", sur un rythme quasi Motown, Kasabian la joue engagé ("In this social chaos/There's violence in the air") dans un délire de handclaps, guitares acoustiques, tambourins, on a même droit à un passage orientalisant très kitsch et pourtant parfaitement jouissif. Ça manque de classe mais c'est imparable, d'autant que l'album révèle ses richesses au fur et à mesure des écoutes. De la musique pour hooligans certes mais jouée par des musiciens qui déploient tout le spectre de leurs influences et capacités. Chaque titre peut-être appréhendé dès le premier passage mais l'album supporte parfaitement les écoutes répétées, dévoilant des subtilités inattendues. Pour sûr, l'écoute de ce disque ne rendra personne plus intelligent, il y a même peu de chances que quiconque fonde un groupe après son écoute (imaginez, faudrait se lever du canapé, jeter les canettes vides, trop de boulot pour une journée) et c'est sûrement pas très tendance mais comme dit précédemment, Kasabian s'adresse aux organes de l'auditeur situés dans la région du ventre et du bas-ventre et personne n'exige plus que cela.
Les modèles ne sont jamais dépassés mais il n'est pas non plus question d'une vaine accumulation de références. "Thick As Thieves" sonne comme un plagiat de The Coral ou de The La's pompés par The Coral, on ne sait plus trop, mais un tel titre dénué de machines joué par un groupe versé dans la culture rave a quelque chose d'inattendu, même lorsque ce dernier se permet des "lalala" en guise de conclusion, peut-être de peur de ne pas pouvoir être repris en chœur dans les stades britanniques. Les samples et effets électroniques vont et viennent, toujours au service des chansons ("Vlad The Impaler"). Si "Club Foot" sur le premier album semblait un peu trop racoleur bien qu'efficace, les morceaux de West Ryder... accrochent l'oreille et tiennent sur la durée (sauf peut-être le titre d'ouverture "Underdog" trop basique). "Fire" ("Comme du Elvis Presley sous acide" dixit le chanteur Tom Meighan) surprend avec une mélodie assez géniale et un refrain disco arrivant sans prévenir pour finir sur des ouh ouh délicieusement crétins. Il faut aussi évoquer "Ladies And Gentlemen (Roll The Dice)", petite merveille subtile, Kasabian alors débarrassé de tous ses artifices vulgaires et à même de donner dans la simplicité pop, peut-être le meilleur morceau de l'album, le plus surprenant aussi.
The Libertines dissous, reformés, séparés ; Kaiser Chiefs toujours plus pompiers ; Franz Ferdinand inintéressant comme à ses débuts ; que reste-t-il du renouveau du rock britannique des années 2000 ? Kasabian. La formation avait débuté comme un sous-produit, une sympathique alternative à Oasis, elle est aujourd'hui plus conforté que jamais dans sa position de leader depuis la dissolution de ses aînés. Il ne lui reste plus qu'à élargir son public hors Albion pour atteindre l'hégémonie qui fut celle des frères Gallagher en leur temps. Alors franchement, à quoi ça sert de nous avoir brisé les esgourdes en nous rabâchant les louanges imméritées de nouveaux groupes garage si c'est pour finalement devoir s'incliner devant le triomphe justifié d'anciens ravers ?
Pierre D
lire la chronique de l'album

Octobre 2009
Comme chacun le sait, le rock est mort entre 1994 et 2001. Il ne s'est évidemment rien passé dans la musique binaire entre le suicide de Kurt Cobain et le retour du rock amorcé par The Strokes. Pourtant ces derniers, destinés à dominer les années 2000 selon la critique rock, se sont tus dès 2006. Ensuite chacun des membres a sorti son album solo dans son coin sans que personne n'en ait rien à secouer (à juste titre d'ailleurs) jusqu'à ce que fin 2009 Julian Casablancas, chanteur et compositeur du groupe, réalise le sien.
Et là surprise, il était rempli de synthétiseurs et de boîtes-à-rythmes. Ces choses qui sont à la musique ce que le godemiché est à l'acte sexuel envahissaient tout le disque et distillaient un parfum années 80 nauséabond. Pour beaucoup c'est la trahison. Le chanteur de leur groupe fétiche, ce type qui avait selon eux mis fin à la dictature electro/techno en réhabilitant une certaine idée du rock new-yorkais (guitares à la Television, voix à la Lou Reed et autres références), se complaît maintenant dans une débauche synthétique et remet au goût du jour ce que les eighties ont produit de plus dégueulasse au niveau sonore. Pourtant les Strokes n'ont jamais réclamé cette image de groupe étendard (contrairement aux White Stripes) d'un retour au rock à guitares (ce terme, déjà...) et encore moins Casablancas dont le mutisme en interview est un cas d'école. Né en 1978 il a grandi dans les années 80 et 90 honnies et ne les a jamais reniées, il n'avait donc aucune raison de sacrifier à une certaine idée du bon goût rock'n'roll. On pourra toujours le taxer de cynisme et de vouloir se raccrocher au train de la pop actuelle, à savoir le triomphe de l'éclate ironique sur synthés pourris mené par MGMT, toujours est-il qu'il y a une cohérence, qui saute aux oreilles en réécoutant First Impressions Of Earth (et plus encore maintenant que Angles a enfin vu le jour).
Passées ces considérations contextuelles, que reste-t-il de cet album une fois la surprise passée ? A première vue pas grand-chose. L'instrumentation est d'une laideur à faire peur, tous ces synthétiseurs baveux qui nous renvoient aux plus belles heures de Bananarama, décidément non ! On aimerait pourtant en faire un chef-d'œuvre incompris, une pièce boudée par ses contemporains qui ne révèlerait ses richesses qu'à une poignée d'initiés... hélas cet album s'inscrit dans la tendance actuelle décrite plus haut et n'a donc aucune chance de passer pour inabordable aux masses. D'autre part, il réussit l'exploit de sonner démodé et kitsch le jour-même de sa sortie, bloqué qu'il est dans des années 80 synthétiques toc dans ce qu'elles ont de plus vulgaire.
Mais alors quelle est la place de ce disque parmi les meilleurs des années 2000 ? Eh bien il se trouve que, même si ça fait parfois mal de l'admettre, Julian Casablancas sait toujours composer des chansons parmi les meilleures de sa génération ("Out Of The Blue", "Tourist"). Même lorsqu'il se lance dans des vocalises que n'aurait pas reniées U2 ("Glass") sa voix limitée mais expressive emporte tout, d'autant qu'elle est mixée très en avant dans la lignée de First Impressions of Earth. C'est affreux, on aimerait détester tout ça, mais ces couplets hallucinants qui mènent à des refrains évidents s'insinuent dans notre cortex cérébral et c'est fichu. En outre, à force d'empiler les couches de son, Casablancas finit par donner une consistance à ces morceaux et même parfois une profondeur comme sur "River Of Brakelights", sinueuse comme pas permis avec un break electro menaçant, ou "Tourist" et ses arrangements moins tape-à-l'œil que sur le reste du disque. Le rythme a beau rester inchangé tout au long de l'album, entre la balade country technoïde ("Ludlow Street") et le tube pop synthétique à reprendre en choeur ("Out Of The Blue"), il y a dans cet équilibre graisseux quelque chose de fascinant. On en vient à aimer ce disque d'abord pour ses chansons mais ensuite parce qu'il n'est pas "cool", en tous cas pas au sens du cool défini par les Strokes à partir de 2001 (jean cigarette, CBGB et j'en passe). Il est gras, boursouflé, d'un mauvais goût (assumé ?) total et devient alors un de ces plaisirs coupables dont tout un chacun raffole.
Le travail de l'auditeur est ici le même qu'avec plusieurs chansons des années 80 gâchées par une instrumentation malheureuse ("Love Will Tear Us Apart") : extraire le diamant de sa gangue. Le morceau n'en devient pas meilleur pour autant, il prouve juste l'idée formulée par Miles Davis qui veut que peu importe le style musical et les instruments utilisés (guitare pour le rock, saxophone pour le jazz), au bout du compte seule importe la mélodie. Et de ce côté-là Julian Casablancas surpasse largement la concurrence des années 2000 finalement plutôt pauvres en chansons mémorables par rapport aux années 80 tant haïes.
Pierre D
lire la chronique de l'album

Août 2009
Des gamins. Quatre grands adolescents vêtus de noirs jouant sans pose ni esbroufe. C’est l’image que renvoie le premier clip des XX. Et pourtant, "Crystalized" fut un des choc de la rentrée 2009, un bouleversement. Et pour cause on avait rien entendu d’aussi simple et touchant depuis le "A Forest" des Cure. Outre-Manche la presse spécialisée fait rapidement des Anglais sa nouvelle coqueluche. La hype gonfle, la galette finit par arriver entre nos mains sceptiques. Quelques écoutes suffisent pourtant à dissiper toute crainte. Car le groupe ne fait pas dans l’électro-rock et ne prétend pas non plus lancer une nouvelle mode. Non, The XX propose une musique minimale et touchante. Deux ans après, leur album reste d’ailleurs un des meilleurs souvenirs de cette fin de décennie. Pourquoi ?
Un son. Celui que les Cure auraient eu s’ils avaient eu vingt ans en 2010. Grosse réverbération sur la guitare, basse ronde, batterie minimaliste (et pour cause, c’est une boîte à rythme). Les compositions sont épurées, mais touchent juste. Elles savent se faire discrètes pour laisser la place au chant, vraie force de The XX. Deux voix au phrasé nonchalant - celle du garçon, celle de la fille - qui se cherchent et se répondent. Dès "VCR" on comprend que tout tient dans cette simplicité. Rien à rajouter, rien à enlever. Tout à été pensé en amont. Chez The XX pas de trace de l’arrogance de celui qui débarque dans la musique avec l’envie de tout changer. Le minimalisme de leur musique en est la plus belle preuve. Derrière les textes simples, les mélodies tristes et le groove, chacun entrevoit un bout de son adolescence, quelque chose d’une représentation idéale de la musique pas encore confronté au business. Cette pureté trouve son acmé sur "Infinity" qui évoque tout à la fois ("Wicked Game" de Chris Isaak, les Cure) et réinvente le jeu de la séduction. A l’image du disque, le morceau ne se préoccupe pas de renouveler le rock ou la pop, mais de tracer une route, de mettre des mots sur les questions de ces adulescents en mal de réponse. Le but est atteint puisque cet album introductif, anachronique et intemporel, éveille au monde et au questionnement, simplement.
Pierre
lire la chronique de l'album