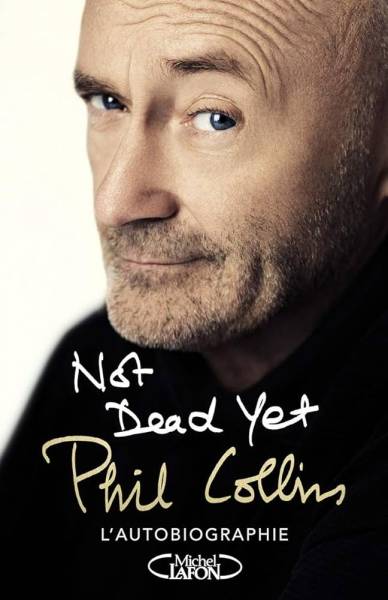Dave Grohl : une odyssée du rock
- Introduction
- Dave Grohl, mercenaire contrarié
- 28 ans au service du rock : les années 80
- 28 ans au service du rock : les années 90
- 28 ans au service du rock : les années 2000
- 28 ans au service du rock : les dernières années
- Sa discographie passée au crible de la rédaction
Dave Grohl, mercenaire contrarié
Figure indéboulonnable du paysage rock des deux dernières décennies, Dave Grohl a survécu à tout : le suicide de Kurt Cobain, la mort du grunge, le départ puis le retour du rock, le déclin de l'industrie du disque... Il est l'une des rares rock stars de moins de 60 ans à pouvoir encore remplir les stades un peu partout sur la planète (sauf en France, perpétuelle exception culturelle). De son arrivée derrière les fûts de Nirvana à son rôle de réalisateur sur le documentaire Real To Reel, retour en forme de droit d'inventaire sur la copieuse carrière d'un leader improvisé mais déterminé, doublé d'un batteur d'exception. Que cache l'éternel sourire du frontman des Foo Fighters ?J'ai toujours trouvé qu'il jurait sur les photos de Nirvana. Comme une pièce rapportée, un intrus, grimaçant de son sourire chevalin, écrasé par le charisme de Cobain. Le blond peroxydé semblait s'en foutre ou esquissait un sourire contrit, quand l'autre s'obstinait à afficher cette perpétuelle mine du ravi de la crèche. Certes, Novoselik avait lui aussi parfois l'air franchement nigaud. Mais il était ce chêne de deux mètres (et un centimètre) sur lequel se reposait le fragile leader. On se souvient de ces images où, à la fin d'un concert proprement achevé par la destruction du matériel, Kris prenait un Kurt prostré dans ses bras pour le raccompagner dans les loges. L'autre gars achevait son drum kit dans son coin, méthodiquement, parce qu'il fallait bien s'adonner aussi à ce rituel un peu idiot. Un salut derrière le micro où il recommande au public de bien se brosser les dents avant d'aller se coucher, puis vient son tour de fermer la marche, les cheveux ruisselant sur sa carcasse rachitique. Comme un bon petit soldat du défonçage de fûts et de l'équarrissage de cymbales. Consciencieux mais seul, au centre de la scène et pourtant jamais totalement à sa place. Eternelle pièce rapportée. Déjà, sur le fameux Unplugged in New York, on souffrait de le voir tapoter obséquieusement ses fûts, la langue plissée, ne sachant ce qu'il fallait faire. Lui dont la mission quotidienne était de bastonner, voilà qu'il lui faut retenir ses coups, tâcher d'accompagner sans les pulvériser des guitares désespérément débranchées.
Un apprenti dans l'antichambre du génie

Il n'a pas dû être évident pour Dave Grohl de joindre la paire, fermement soudée depuis les tréfonds de la bouseuse Aberdeen. Les affinités électives n'ont pourtant pas dû peser bien lourd face au talent du bonhomme. Nirvana avait besoin d'un V8 sous son capot, de sonner gros. Le candidat remplissait parfaitement cet office. Pour le reste, on ne sait jusqu'à quel point l'alchimie humaine a fonctionné entre le leader et sa dernière recrue mais on a bien remarqué qu'ils géraient chacun à leur façon la tornade grunge. Grohl observait le phénomène avec un détachement amusé, Cobain se cognait la tête contre les murs. Paraîtrait que vers la fin, Dave commençait à lui taper grave sur le système. Et on ne parle pas ici de cette foldingue de Courtney Love qui prétendait qu'il la draguait dans le dos de son camarade, juste de ce que d'ordinaire les communiqués officiels qualifient pudiquement d'"incompatibilité d'humeur". Peut-être Kurt ne supportait-il plus l'insouciance de son camarade, lui qui s'avérait incapable de gérer son statut d'icône. Peut-être en était-il venu à mépriser cet artificier d'exception qui lui avait apporté sur un plateau l'efficacité rythmique qui lui manquait, contribuant à lui procurer cette gloire qu'il recherchait secrètement sans jamais se l'avouer. Peut-être une certaine rancoeur larvée s'était-elle installée entre les deux hommes. De son côté, Grohl en avait peut-être marre des jérémiades du Christ Clearasil et de sa punk rock guilt gémissante. Le vent de la hype allait bien finir par retomber, pourquoi s'en soucier ? Pourquoi ne pas profiter bêtement et simplement de ce grand huit d'un rire rigolard et désabusé ? On disait la fin de Nirvana de toute façon proche, sabordé au faîte de sa popularité. Le batteur avait inconsciemment pris les devants, enregistrant quelques démos sur une cassette sous le pseudonyme Late! entre deux day-off de la tournée Nevermind, peut-être l'ébauche d'un side-project rafraichissant auquel il s'adonnerait en attendant que l'autre termine sa crise existentielle. On bien savait-il son éviction proche et préparait-il déjà sa reconversion ? On doute qu'il nous dise un jour le vrai mot de l'histoire. Amitié sincère ou relation essentiellement fondée sur l'intérêt, toujours est-il qu'une sorte de pacte tacite s'est noué entre les deux musiciens. Le batteur apporte sa formidable force de frappe, le chanteur l'initie en retour au processus d'écriture d'une chanson, lui permet d'assister au spectacle d'une sensibilité et d'un talent d'exceptions en action, le convie dans l'antichambre du génie. Bosseur et volontaire, l'apprenti prend des notes.

Dave Grohl ne met pas longtemps à ruminer ses premiers pas dans le songwriting. Bientôt l'idole trépasse. Pour cet hyperactif pathologique qui a toujours besoin d'avoir trois projets en préparation pour avancer, il est impossible de prendre le même chemin que Kris Novoselic, abasourdi de chagrin, accablé par la douleur, incapable de réagir. Aussi ne se fait-il pas prier lorsque Tom Petty lui propose de remplacer son batteur lors d'une tournée, à l'issue de laquelle le Floridien, conquis par sa recrue (on l'imagine aisément !), lui propose de garnir officiellement ses rangs. Deux routes se présentent à lui, et ce dilemme lui sera régulièrement posé tout au long de son parcours : continuer d'être ce gamin ravi de participer au voyage, ou bien se risquer au jeu de l'aventure personnelle. L'ex-Nirvana tranche et décline la proposition, mais on donnerait cher pour savoir ce qui s'est passé dans sa tête à se moment-là. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance ? Pourquoi a-t'il tourné le dos à ce qui lui avait tant réussi jusque-là ? Il aurait très bien pu connaître une très belle carrière de mercenaire quatre étoiles (dans le sens positif du terme, on ne parle pas d'un Zlatan Ibrahimovic du rock), le meilleur cogneur de sa génération, celui qui collectionne les collaborations prestigieuses, l'aide providentielle qui vient sauver un groupe à la dérive ou qui sert de tremplin à des formations prometteuses. Or voici trente ans que les Beatles ont consacré la figure du songwriter. Depuis eux, on n'est véritablement musicien que si l'on participe à l'écriture des morceaux, ou que l'on est au moins la principale cheville ouvrière de son groupe. Sinon on n'est rien. Le musicien du studio devient un vestige du passé, une figure obsolète que l'on considère avec condescendance, voire mépris. Jimmy Page, pièce maitresse du monstre Led Zeppelin, savait pourtant toute la dette qu'il devait à son passé d'intérimaire des studios et a toujours respecté cette fonction. Jeff Beck aussi. Mais Dave Grohl a peut-être été échaudé par la trajectoire de Nirvana, lui qui avait assisté, impuissant, au spectacle de son leader sabotant consciencieusement le navire. Autant voir jusqu'où on peut aller quand on fait les choses à sa façon.
Jovialité et poigne

Artistiquement parlant, la trajectoire est plus discutable. Dave Grohl n'a manifestement pas de vision claire quant au visage qu'il veut donner à son groupe, dont il trouve vite le nom idiot. Le vernis grungy du premier album n'est principalement dû qu'à son enregistrement effectué dans l'urgence et il souhaite par-dessus tout que sa nouvelle entité ne passe pas pour un ersatz du combo de Seattle. Pourtant Nirvana flotte encore dans l'air, les figures tutélaires revendiquées par Cobain avec. Hanté par son surmoi pixien, Grohl enfante The Colour And The Shape sous la houlette de Gil Norton, avide de s'accaparer l'excentricité foisonnante d'un Trompe le monde. Déterminé à s'éloigner le plus possible du disque homonyme, il tombe dans l'excès inverse, multipliant les prises et les placements de micro, laissant William Goldsmith et Pat Smear sur le carreau. Le résultat est contrasté : la première moitié de l'album reste la plus intéressante de la discographie du groupe, mais s'esquissent en contrebande les points cardinaux qui fixeront définitivement son style, son goût pour le stances FM gentiment énervées ("Monkey Wrench"), le rock de stade poussif ("My Hero") et les refrains pompiers ("Everlong"). Le traitement de choc indie ne sied pas aux très prosaïques Foo Fighters. Bouclé dans une ambiance beaucoup plus détendue avec un line-up enfin stabilisé, There Is Nothing Left To Lose les voit arborer une power pop bétonnée enfin taillée à leur mesure. Les singles accomplissent parfaitement leur objectif radio friendly ("Learn To Fly", "Breakout"), un savoir-faire idéalement caréné et une assurance laid-back portent l'ensemble sans encombres ("Gimme Stitches", "Next Year", "Ain't The Life"). Ce troisième opus reste le plus homogène de leur discographie et leur ouvre les portes des grandes arénas. Un premier bilan se dessine alors : Grohl s'avère être un songwriter limité et un chanteur médiocre, compensant son manque de personnalité par un professionnalisme à toute épreuve et un sens très sûr de l'efficacité. Il creusera son trou aux points, et non par K.O.

Un nouveau millénaire s'ouvre et les Foo Fighters semblent partis sur de bons rails, se dotant du guitariste Chris Shiflett pour muscler son line-up. Pourtant le groupe va mal, la gestation du quatrième disque est un calvaire. Le patron s'avère peu inspiré, n'aime pas ce qu'il enregistre et ne peut compter sur l'aide de ses troupes, rincées par une tournée des stades menée en compagnie des Red Hot Chili Peppers. Il a voulu s'entourer de soldats carrés et dociles, il en paye à présent le prix. Impossible de se reposer sur ces musiciens compétents mais peu imaginatifs pour qu'ils fournissent des idées fraiches. C'est alors que Josh Homme lui tend un bras salutaire. Ses Queens Of The Stone Age ne se portent guère mieux. Le producteur dépêché pour enfanter Songs For The Deaf (Eric Valentine) a été remercié et le batteur Gene Trautman vient de laisser son tabouret vacant. Cela faisait quelques temps que Dave Grohl lorgnait sur le combo californien. Fan de Kyuss depuis Blues For The Red Sun (1992), il avait toujours suivi la carrière du géant rouquin du coin de l'oeil et se serait déjà bien vu derrière les fûts sur Rated R s'il n'était accaparé par la tournée de There Is Nothing Left To Lose. L'homme ne se fait pas prier, empoigne ses baguettes et se réfugie chez son compère dans un état de surexcitation intense. L'ambiance change du tout au tout. De retour à sa fonction première, le cogneur boucle ses parties en une poignée de jours, ripaille avec ses nouveaux camarades de jeu, retrouve du plaisir, abat des forêts de séquoias avec une banane extatique sur les quelques dates soutenant la sortie du disque. Panique à bord chez les Foos restants, qui voient leur leader les abandonner pour un voyage qu'ils craignent sans retour.
Une impitoyable sélection darwinienne

Ainsi, il tourne encore le dos à ce destin qui l'avait conduit à perpétuer le don avec lequel il est né, et qui le porte plus à marteler comme personne qu'à éructer ou gratouiller comme n'importe qui. Abasourdi, on écoute encore avec quel bonheur, quelle maestria, quelle furie communicative il porte Songs For The Deaf à l'excellence, la rythmique cataclysmique de "A Song For The Dead", le tempo acéré de "First It Giveth", la marche ténébreuse de "God Is In The Radio"... Sa frappe animale, musculeuse, imaginative, finalement plus féline que celle de son modèle éternel, John Bonham, n'a jamais fini de nous laisser pantois. S'il daignait se prêter à l'exercice, un disque de solos de batterie vaudrait tellement plus qu'un nouveau Foo Fighters. Le bonhomme aurait pu devenir une sorte de Max Roach du rock US. Bon sang, à quoi rime cet entêtement ? Pourquoi diable combat-il sa véritable nature ? Est-ce que seul l'égo explique l'affaire ? On se console toutefois. L'épisode QOTSA a durablement imprimé sa marque au fer rouge. S'il n'avait jusqu'ici accumulé qu'une poignée de collaborations ponctuelles, tout en portant pendant de longues années le projet Probot, récréative incartade heavy metal, son retour à la batterie devient de fait définitif, et depuis lors il conciliera son mercenariat percussif avec son poste de frontman. Dès l'année suivante il se porte à la rescousse de Killing Joke, sur le point de ressusciter son indus primitif. Les critiques ont peu commenté ce disque, et les fans du gang de Jaz Coleman ne semblent pas le porter beaucoup dans leur coeur, pourtant la frappe de Grohl y fait encore merveille. Il y montre une violence et une cruauté inouïes, un aspect de son jeu qu'il aura peu exploité dans sa carrière. Ailleurs, il épaule Trent Reznor sur son très rock With Teeth, se porte au chevet des Garbage du placide Butch Vig, cautionne la pantalonnade Tenacious D de son pote Jack Black, ou vient doper le carburant rythmique du backing band de l'actrice Juliette Lewis. Souvent réjouissant, parfois anodin, le fruit de ces collaborations ne se révèlera jamais aussi explosif que son association avec Josh Homme. Grohl n'a pas de baguette magique, ne transformera pas votre citrouille en carrosse. Mais on peut compter sur lui pour amener le véhicule à bon port et sur les chapeaux de roues.

Sachant qu'il a oeuvré pour la postérité avec Songs For The Deaf, Dave Grohl assume enfin son rôle de leader avec sérénité, dictant à ses troupes la marche à suivre avec la même autorité volontaire que Paul McCartney lorsqu'il reprit en main les Beatles à la mort de Brian Epstein. Le gaillard ne ménage pas ses efforts pour présenter à ses comparses et au reste du monde un nouveau pont d'Arcole à franchir tous les deux-trois ans. On fait le show en salle, tandis qu'en cuisine on accommode le plat du jour en utilisant le même fond de sauce. Pourtant aux dires de son frontman, le quartet est en révolution permanente : l'option du double album tentée avec un courage qui force l'admiration près de 40 ans après le double blanc (In Your Honor), les tournées acoustiques, du jamais vu jusqu'ici, le retour de Gil Norton à la production comme gage de remise en question (Echoes, Silence, Patience & Grace). Autant d'efforts qui paraissent comiques, parce qu'un peu pathétiques, tant ils ne font que buter contre les bornes définies jadis par One By One. En dépit de ses ravalement cosmétiques, la machine Foo Fighters reste la même, dégobillant ce rock efficace et linéaire à la production clinquante et sur-bétonnée. Là est son centre de gravité, là son horizon indépassable.
Boucler la boucle

Ni pire ni meilleur que se prédécesseurs, Wasting Light entérine cet était de fait. L'autre bouffe les pissenlits par la racine, lui est bien vivant. L'icône déchue a redonné au rock son parfum incandescent, son âme damnée ; son ancien compagnon de jeu fait le boulot à sa manière, perpétuant cette musique en compensant ses limites artistiques par un activisme forcené. Dave Grohl gardera toujours le regard rivé vers l'avant, même quand il fait mine de reluquer le rétroviseur. Pour le reste, que les morts enterrent les morts. Il n'y a pas de cynisme froid dans cette aventure. Il sait mieux que personne tout ce qu'il doit à Kurt Cobain, ne serait-ce la facilité avec laquelle il a pu mettre ses Foo Fighters sur orbite, et sans doute considère-t-il son rôle de légataire du monstrueux héritage de Nirvana avec la meilleure conscience du monde, toujours désireux de bien faire. Mais le poids des années et l'ampleur de sa discographie ne cessent de hurler à quel point il s'inscrit davantage dans le sillon de la scène alternative moussée par les majors à la suite de l'effervescence grunge que les marginaux défendus par l'ange d'Aberdeen, ceux qui donnaient depuis les années 80 un réel sens, aussi bien économique qu'artistique, au terme alternatif. Le rock que pratique le camarade Grohl a plus à voir avec Stone Temple Pilots que Mudhoney ; plutôt, mettons, Buckcherry que Butthole Surfers. Et ce quoiqu'en pense le lascar, quand il invite par exemple Bob Mould à trousser quelques couplets sur un "Dear Rosemary" dont on s'épuisera à se figurer quel genre d'hommage il peut bien rendre à Hüsker Dü. De même on se demande s'il cherche encore à poser une nouvelle pierre sur l'édifice rock avec les Them Crooked Vultures, ou s'il ne s'accorde pas tout simplement un petit caprice, confortablement calé entre un Josh Homme bouffi d'orgueil et un John Paul Jones ravi d'exhiber son excentrique collection de basses, reconduisant la lourdeur satisfaite, maligne mais stérile, qui fut l'apanage de tant de supergroupes depuis au moins Blind Faith.

Dave Grohl s'est toujours désespéré de cette France qui se refuse à ses Foo Fighters, qui rechigne à leur offrir un Bercy rempli quand ils bourrent les stades partout ailleurs. C'est qu'il ne se rend pas compte que n'avons jamais su que faire de ces rockeurs-entertainers, juste désireux de nous faire passer un bon moment, qui apprécient le bonheur simple d'une guitare qui ronronne et d'une batterie qui bastonne, sans chercher à chambouler de si insubmersibles fondations. La France reste rétive aux Foo Fighters (ou plutôt lui présentera des Zéniths garnis et ravis de les accueillir si le frontman daignait revoir ses ambitions à la baisse), tout comme elle est restée (malheureusement) frileuse face à Tom Petty, tout comme elle a loupé Weezer, Fountains Of Wayne, Ash et Feeder, ambassadeurs de la power-pop américaine en pleine ère brit-pop, elle pour qui Creed, Jimmy Eat World, American Hi-Fi, Sugar Ray, Nickelback ou Hoobastank ni signifient pas grand chose en dehors de quelques ballades parues ici ou là. Ici on demandera toujours quelque chose de plus aux singles linéaires de ce rock mainstream et sans aspérité, parfois au risque de lui préférer l'esbroufe arty au savoir-faire assuré de cet artisanat séculier. Nos enfants découvriront "Time Like These" ou "The Pretender" sur la radio K-DST de Grand Theft Auto 15, et ils arboreront devant l'exotisme de ce rock décomplexé le même sourire que le nôtre, lorsqu'à leur âge nous découvrions Foghat, Heart ou Boston lors d'une virée sur l'autoroute de San Andreas. C'est à cette cohorte de combos anonymes, oubliés des chapitres de l'histoire du rock parce qu'ils se contrefoutaient de lui amener quelque chose d'inédit, juste ravis de le servir comme il se doit, que Dave Grohl doit sa filiation. Ses Foo Fighters ne sont qu'un ravaudage moderne des antiques travaux de Foreigner, Styx, Ram Jam, Journey, Cheap Trick, Bad Compagny, ou Toto pour être vraiment méchant, et non des émules de Sonic Youth ou de Fugazi. La chose est entendue.
These are my famous last words

Comme à la vision de Back & Forth, un même sentiment de malaise nous envahit devant le spectacle de ces musiciens aguerris, pratiquant leur art en charentaises, s'autocongratulant à coup de "amazing", "it's magical", "that's rad, man !" McCartney vient s'encanailler auprès de ses convives éberlués, babillant un ersatz d'"Helter Skelter". Ailleurs Josh Homme et Trent Reznor alignent un "Mantra" en pilotage automatique pour rendre service à leur pote. On est en revanche ravi de retrouver un Chris Goss si rare derrière le micro, parfaitement servi par la section rythmique de Rage Against The Machine. Tout cela respire l'ambiance chaleureuse, pas vraiment le dépassement de soi. On a envie de prendre Dave Grohl par le colback et de le secouer : mais tu ne te rends compte de rien ? Tu ne comprends pas que tout l'équipement vintage du monde ne te rendra pas soudainement inspiré ? Qu'un kilomètre de bandes et une console de légende ne transforment pas le plomb en or ?
Sans doute se défera-t-il de notre étreinte et s'en sortira-t-il par une pirouette et un grand sourire. Et remportera la mise au final. Comme toujours. Les rock critics se demanderont longtemps pourquoi un batteur si exceptionnel s'est entêté avec un tel acharnement à porter à bout de bras ses si anodins Foo Fighters. Le bonhomme n'en a cure, lui qui vit depuis plus de vingt ans un rêve de gamin éveillé, accrochant à son imposant cv, chaque mois que dieu fait, des collaborations plus ou moins fructueuses avec les figures majeures du rock anglo-saxon, gloires des décennies passées comme valeurs sûres du paysage contemporain. Mercenaire zélé, frontman consciencieux, Dave Grohl reste surtout un artisan dévoué, un activiste enthousiaste, un passionné jamais blasé. Nous ne sommes jamais dupes de la camelote qu'il nous refourgue, mais il reste un point de repère, un emblème qui nous rappelle le plaisir brut que peut procurer le rock, celui qui nous avait cueilli adolescent. Qu'importe si l'ivresse n'est pas toujours de mise. On peut le louer ou l'ignorer, le célébrer comme le mépriser, le type fait indubitablement partie du décor, et tous les aigris du monde ne sont pas près de déloger ce grossium à la santé de fer. Qu'on se le dise, like it or not, SuperDave nous enterrera tous.
Maxime
http://buy.soundcitymovie.com
http://www.foofighters.com/us/home