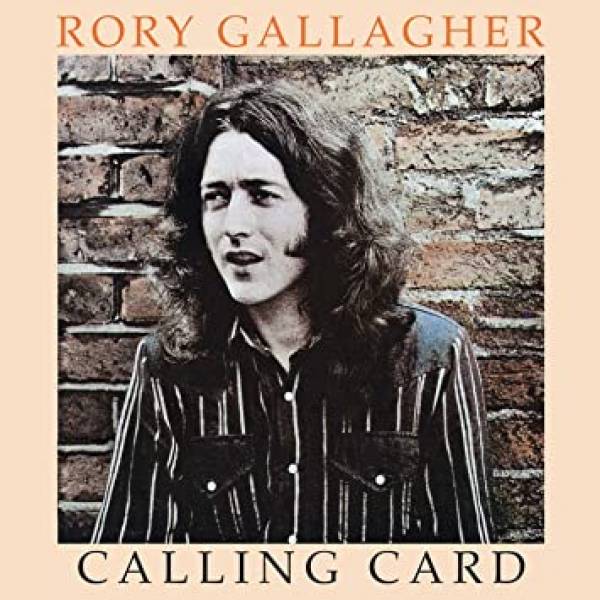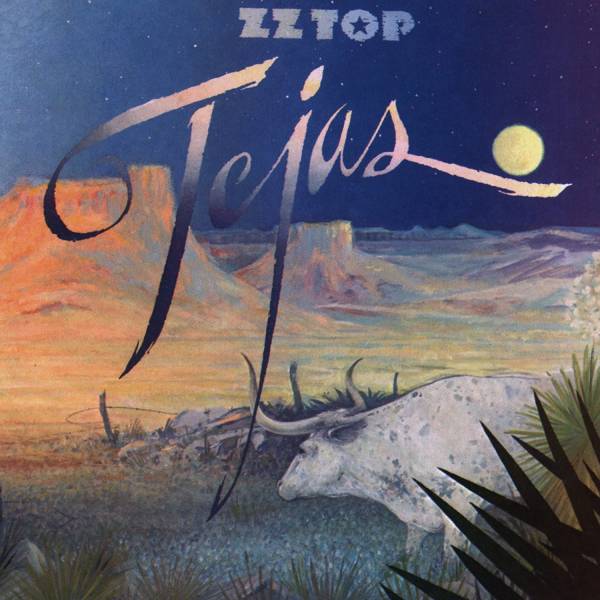Kurt Cobain - About A Son
Arcades Video
sortie le 2 juin 2009
Kurt Cobain aura livré beaucoup de choses au monde du rock durant sa courte existence : une discographie aussi sèche qu’intense (trois albums, un célèbre live acoustique à l’importance toutefois un peu exagérée et une multitude de cassettes de démos, reprises et ébauches qu’on n’aura pas fini de nous proposer tous les 5 ans pour relever les compteurs), une esthétique de la mélodie et de la fureur reliant avec une évidence paradoxale blues, punk, hard rock, pop et binaire lo-fi, le dépassement des cloisons séparant mainstream et indie… Mais son legs le plus pesant sera une domination post mortem des esprits qui dure encore aujourd’hui. Sa fin tragique a oint son répertoire d’une aura mythique totalitaire. Car plus de 15 ans après sa mort, la planète rock vit toujours sous le joug du cerveau de Nirvana. Un joug étrange, car il ne dit jamais son nom, ne révèle jamais sa nature. Sur un plan factuel, les t-shirts et les affiches à l’effigie de l’icône grunge abondent moins qu’il y a quelques années. Rares sont également les groupes actuels qui se revendiquent explicitement de l’héritage du combo de Seattle et on ne peut pas vraiment dire qu’en dehors des mastodontes en semi-activité (Alice In Chains, Pearl Jam) on assiste à la naissance d’une scène post grunge. Pire, les horreurs metal des eighties que l’auteur de "Smells Like Teen Spirit" avait salutairement expédié vers la tombe reprennent vie : Mötley Crüe ressort ses spandex fluo à l’occasion d’une tournée estivale, on s’est passionné pour Chinese Democracy, le brouet indigeste de l’insupportable mégalomane Axl Rose. Nirvana serait-il un groupe de légende stérile, incapable d’accoucher d’une descendance ? C’est que le despotisme de Cobain est sournois. Son suicide a provoqué un traumatisme terrible qui ne se manifeste que sur le plan de l’inconscient. On n’en parle pas mais il est là, tapi dans l’ombre, prêt à se manifester comme une tumeur maligne.
Pourtant, Nirvana est aujourd’hui un groupe de classic rock. Leurs clips passent dans les émissions type "rétro 90’s", leurs disques sont pressés en vinyles 180 grammes dans la gamme Back To Black, dans la même série que Jimi Hendrix, Velvet Underground, Nevermind est disséqué dans un DVD documentaire au même titre que les œuvres de Who, Sex Pistols et autres, chaque sortie d’inédits se solde par son lot d’articles commémoratifs. On a l’impression que le temps et l’absence ont domestiqué cette musique si fiévreuse, a la fois si immédiate et si riche, presque insupportable dans sa pureté, son évidence. Alors que tout le monde cherche le nouveau Nevermind. Chaque fois qu’un disque apparaît mieux foutu que les autres, ça y est, voilà qu’on annonce qu’il jouera côte à côte avec l’album à la pochette marine. Comme une armée de religieux illuminés, on cherche à s’en accaparer les reliques pour bénéficier des miettes de son aura. Dave Grohl joue chez les Queens of the Stone Age, et on placarde Songs For The Deafs Nevermind des années 2000 alors que ses (très) hautes vertus se situent ailleurs. On traque la collaboration de Butch Vig pour espérer se baigner dans les mêmes eaux que le bébé du chef d’œuvre, des Smashing Pumpkins à Green Day récemment. Le rock est en manque de ce vertige délicieux, d’un monolithe qui pourrait souder devant lui toute une génération comme un seul homme. Le rap a Eminem. Qu’a le rock aujourd'hui ?
Il y a deux façons de tuer un mythe. La première est de le dissoudre et de le substituer par un autre, qui ne le remplacera pas, mais tournera au moins les regards vers quelqu’un d’autre. Mais personne n’a réussi à damer le pion à Cobain. Son suicide a été un choc qui a laissé le rock en semi-coma, laissant la porte grande ouverte aux années de plomb électro que ni Oasis ni Blur, ni Green Day ni Offspring, ni Korn ni Limp Bizkit n’ont su endiguer. Il y aura toujours quelqu’un pour dire que les frères Gallagher sont des crétins doublés de pilleurs sans nuance, que Dookie n’est qu’une bouse scatologique préparant le terrain aux lamentables Blink 182 et Sum 41, que le nu-metal est ce que le rock a produit de plus pathétique de toute son histoire. Alors qu’il y avait un unanimisme absolu à louer Nirvana. Du rock critic élitiste à l’adolescent boutonneux, du manager de BNP Paribas au professeur de lettres gauchiste, du pré-pubaire au cinquentenaire, tout le monde les aimait. Sans une voix dissidente dans la salle pour broncher. Il paraît que le rock est revenu en 2001. Ceux qui n’avaient jamais cessé de l’écouter n’avaient pas remarqué qu’il était parti. Quand il sera bientôt l’heure de faire le bilan de cette première décennie, on se rendra compte qu’il s’agit surtout d’un retour médiatique. Le grand public, lui, n’a pas suivi, personne n’a fédéré comme Cobain. Julian Casablancas a relancé la mode des Converse mais n’a pas marqué les consciences. Craig Nichols est une parodie pathétique de son modèle. Jack White a dominé les ondes avec "Seven Nation Army", mais c’est en réalité un artisan du blues, dont le savoir-faire mélodique est insuffisant pour conquérir durablement les foules. Le succès du single des White Stripes est presque une erreur de parcours. Pete Doherty ne fascine qu’un parterre de romantiques, la grande majorité le prend pour un junkie débile et n’a jamais écouté un disque des Libertines. Thom Yorke est trop distant, trop dilué dans la machine-cerveau qu’est Radiohead pour prétendre à l’incarnation d’un mythe. Tous esquivent Nirvana. On pompe sans vergogne les sixties, seventies et eighties, mais on prend bien soin d’escamoter les nineties. On évite soigneusement de se pencher sur une période qui n’a pas encore cicatrisée ses plaies.
L’autre option est de figer le mythe, de le disséquer, pour en chasser la moindre trace de mystère et ainsi le rendre tout à fait digérable, l’expliquer de façon logique, presque scientifique. Comme on l’a déjà évoqué, cela n’a été fait que façon superficielle. Cobain est peut-être un personnage lointain pour les jeunes d’aujourd’hui, mais il hante encore ceux qui ont grandi dans les années 90. L’origine du mythe, c’est bien sûr son suicide. Geste absurde : a quoi bon se faire sauter le caisson une fois parvenu au sommet ? On a souvent dépeint le compositeur de In Utero sous la figure christique. Cobain est mort pour les pêchés du rock, pour être passé de l’underground au mainstream sans se compromettre. La belle affaire. Aujourd’hui, en pleine crise du disque, en plein règne du mp3, cette opposition n’a plus lieu d’être, la fée digitale s’en serait chargée pour lui. Ce geste fatal l’a bien sûr fait accéder à l’immortalité. Jamais nous ne verrons Kurt vieillir, sortir des albums de Nirvana moyens, splitter puis reformer le groupe ou lancer un projet solo blues. Jamais on ne verra le Dieu faiblir, chuter ou même trébucher, comme Lennon qui a eu le temps de glisser quelques disques solos ternes. Mais surtout, sa trajectoire erratique et fulgurante a laissé une soif intacte d’explication. On cherche à savoir comme il a pu en arriver là. Car Lennon ou Hendrix ne sont pas morts de leur seul fait, c’est un hasard terrible ou une fatalité sordide qui s’en est chargé. Alors que, comme Ian Curtis, Cobain a choisi délibérément son issue. On a alors violé son intimité en se repaissant de ses carnets intimes expurgés, échafaudé de douteuses théories de complots impliquant Courtney Love. Que de littératures lamentables pour n’entrevoir Nirvana que sous l’angle de son dénouement tragique. Comme si toute cette musique, cette passion sincère pour le rock ne pouvaient se comprendre que sous cette focale. Ce faisant, on a écrasé le répertoire du groupe de Seattle sous ce verbiage déterministe, occultant trop la singularité de l’œuvre, son esthétique, ses influences. Seul le DVD Classic Album consacré à Nevermind va dans ce sens. Mais le processus n’a pas encore été entendu à tout le répertoire.
C’est dans ce contexte que sort le DVD Kurt Cobain – About A Son. Ce projet documentaire singulier compile des bandes d’interviews réalisées par le journaliste Michael Azerrad au domicile des Cobain, le plus souvent au beau milieu de la nuit. Un matériau riche de 25 heures jusqu’alors inexploitées, que AJ Schnack (déjà auteur d’un documentaire sur They Might Be Giants) va se charger de mettre en images. Sur le papier, le projet est très séduisant. Cobain raconté par lui-même, par ses propres mots, sans que quelqu’un vienne par derrière déformer sa pensée. Hélas, cette intention de départ est complètement prise en contradiction avec le dispositif employé.
Le plus grand mérite du film est sa construction, qui se scinde en trois parties : Aberdeen, cité forestière d’un ennui sordide, l’effervescente Olympia et la prospère Seattle. Elle enterre une bonne fois pour toutes toute confusion entre Aberdeen et Seattle, dont la dernière a trop souvent été affublée des oripeaux misérabilistes propres à Aberdeen. Mais surtout, elle met en valeur avec le chapitre consacré à Olympia une partie de l’existence de Cobain qu’on connaît peu, celle où il va passer une vie de bohème avec sa petite amie de l’époque dans une ville beaucoup plus ouverte artistiquement parlant. Paradoxalement, il s’ennuiera assez vite, son amour du punk rock ne correspondant pas avec le microcosme local.
Mais le plus gênant reste le parti pris de ne jamais faire figurer Cobain à l’écran (à l’exception de quelques clichés en toute fin). Se succèdent alors de vastes panoramiques de paysages, des plans fixes s’attardant sur quelques décors et travailleurs dans leurs occupations quotidiennes, et de grotesques gros plans de visages anonymes. Seule la voix, grinçante, déjà lasse, du musicien atteste de sa présence. Il apparaît alors comme une espèce de Dieu omniscient, régnant aux quatre coins de l’écran. Au lieu de le dissoudre dans les lieux qui l’ont vu évoluer, il les embrasse tel un working class hero transpirant de tous les visages et paysages comme s’il les marquait tous d’une empreinte indélébile. Cette fausse pudeur le rend omniprésent et plonge le film dans une atmosphère étouffante qui met rapidement mal à l’aise. Ce parti pris douteux s’immisce également dans le choix des extraits d’interviews. Le mot Nirvana n’est presque jamais évoqué. En déconnectant à ce point l’œuvre de son auteur, on occulte complètement le fait qu’il est avant tout un musicien. On se moque de savoir dans quelles circonstances il a écrit "Lithium" ou "Rape Me". Seule la Vérité intime du personnage importe. Soit. Mais Cobain est quelqu’un de complexe, fuyant dès qu’on essaie de l’approcher. Ses carnets intimes, qu’il ne voulait pas que l’on publie, ne nous avaient pas appris grand-chose. C’est également le cas ici. L’icône peroxydée parle des sentiments contradictoires pour les gens, qu’il souhaite aimer et comprendre autant qu’il les méprise "pour leur méchanceté", de son enfance où se il se croit fils d’extra-terrestres, de sa volonté délibérée de devenir un junkie pour oublier ses souffrances lombaires et ses maux d’estomacs que plusieurs spécialistes n’ont jamais arrivé à traiter. Il se justifie souvent, de sa relation avec Courtney Love, complètement réinventée par les journalistes people (qu’il hait par-dessus tout), de son personnage de star paumée, qu’il juge faux, il se dit tout à fait capable de lancer des blagues, mais se plaint que cet aspect de sa personnalité ressorte peu à cause d’un Kris Novoselic plus exubérant… C’est parfois intéressant, mais souvent anecdotique parce qu’on fait toujours mine d’oublier que Kurt Cobain était quelqu’un dont la principale occupation était d’écrire des chansons. Et de cela pas un mot. Egalement absent de la bande-son (alignant ses influences, Queen Creedence Clearwater Revival, Melvins, R.E.M., Bowie…), Nirvana est le grand absent de l’affaire. Prétendant toucher au plus près de l’homme, Schnack passe complètement à côté du sujet. Ce qu’il faut, c’est faire ce qui a été fait pour les Beatles (Anthology), les Who (Amazing Journey) ou les Ramones (End Of The Century). Un documentaire sans ostentation, avec la musique, son contexte, son évolution comme seuls objets. Il faut constituer ce marbre mortuaire, lisse et solide, pour enfin remplacer les choses calmement dans le bon ordre, sans évacuer le mythe, mais sans tenter de le lustrer un peu plus sous le fallacieux prétexte de le mettre à nu. La tâche n’est pas facile, tant Cobain ne semble pas avoir évacué sa capacité de sidération. "Love you so much, it makes me sick".