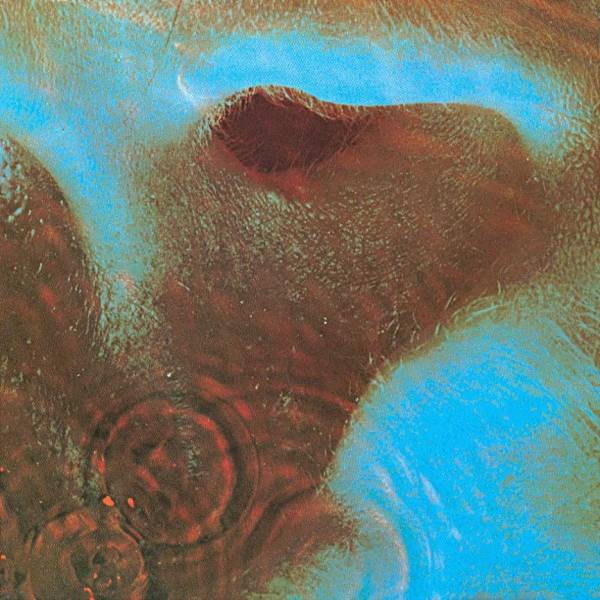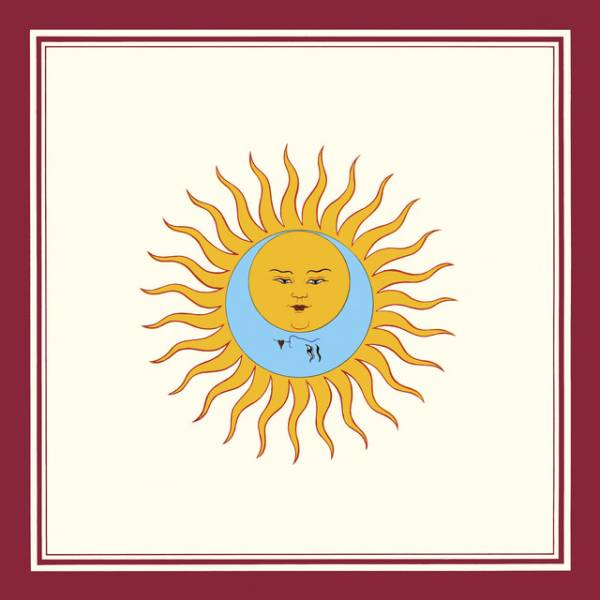King Crimson
Islands
Produit par King Crimson
1- Formentera Lady / 2- Sailor's Tale / 3- The Letters / 4- Ladies of the Road / 5- Prelude: Song of the Gulls / 6- Islands


Islands est un disque qui multiplie les paradoxes. Sans doute l’album le moins aimé du Roi Pourpre, ce quatrième essai suscite également des passions démesurées auprès de certains aficionados. Sans doute son album le plus éclaté et schizophrène, il est aussi, assez inexplicablement, l’un de ceux dans lequel il est le plus facile de se plonger et auquel il est le plus facile de s’attacher. L’un des plus bizarres et atypiques comme l’un des plus fascinants. Bien que non dénué de déchets, il comporte en son sein des fulgurances d’une sidérante beauté. Rien que pour ce caractère hors normes, même pour une formation aussi versatile et peu balisée que King Crimson, Islands mérite plus, bien plus, qu’un simple coup d’oreille à la sauvette.
Quand Lizard sort dans les bacs à la toute fin de 1970, la formation emmenée par Robert Fripp et Peter Sinfield va mal. L’accueil de ce troisième disque est frileux, et sa genèse ainsi que son enregistrement conflictuel ont effrayé Gordon Haskell, venu déjà suppléer en quasi-catastrophe le départ de Greg Lake, sans compter qu’il ne goûte guère aux facéties jazzo-classiques de l’album en question. Bien qu’ami d’enfance de Fripp, il ne se voit pas supporter la tutelle autoritaire de ce dernier sur le long terme et décide de prendre ses distances, bien vite suivi par le batteur Andy McCulloch. La majeure partie de 1971 est donc allouée à l’embauche de remplaçants aux deux hommes, chose rapidement faite en ce qui concerne le poste de batteur qui échoit à Ian Wallace (ex The Warriors, la première formation de Jon Anderson de Yes). Le second poste, cependant, est nettement plus difficile à trouver, d’autant que Fripp n’arrive pas à envisager l’idée qu’un bassiste ne soit pas également chanteur - c’était le cas de Lake et d’Haskell. Les auditions s’enlisent, un certain John Wetton est un temps approché mais finit par décliner - pour mieux revenir quelques années plus tard, mais passons pour l’heure. Finalement, le guitariste jette son dévolu sur Raymond “Bozz” Burrell (ex Centipede - on dit même qu’il fut un temps pressenti pour remplacer Roger Daltrey chez les Who) et lui enseigne personnellement la quatre cordes, chose pas bien compliquée pour Bozz qui maîtrise déjà la guitare acoustique. S’ensuit une nécessaire tournée axée essentiellement sur les deux premiers albums de King Crimson - les pièces de Lizard n’ont quasiment jamais été jouées en live, et encore moins à cette époque. Il faut attendre octobre pour que la fine équipe entre en studio, avec donc toujours Peter Sinfield aux textes (unique rescapé du Crimson d’origine avec Fripp), Mel Collins au saxo et à la flûte traversière et Keith Tippett au piano (encore une fois, ce dernier n’a jamais intégré officiellement le groupe), auxquels s’associent joueurs de hautbois, violon, violoncelle, contrebasse et cor. Deux mois plus tard seulement, Islands arrive dans les bacs.
Mais déjà une faille s’est irrémédiablement créée entre Robert Fripp et ses hommes. Les tournées de 71 ont mis en exergue l’abysse séparant d’une part le trio Bozz - Wallace - Collins volontiers fêtard et avide d’excès toxiques en tous genre, et d’autre part le stoïque guitariste qui se refuse catégoriquement à toute consommation de substances illicites. Pire, le divorce est consommé entre lui et son vieux compère Peter Sinfield qu’il accuse de l’échec critique et publique de Lizard à cause de sa fusion jugée trop osée, sibylline et hermétique entre rock, jazz et musique classique. Pas question pour Fripp de reproduire les mêmes erreurs, et si la fibre jazzy et expérimentale de Sinfield a encore voix au chapitre sur Islands, ce n’est qu’à la condition extrême que le guitariste garde le dernier mot. Quant aux influences classiques chères à Fripp, elles se retrouvent isolées de manière à éviter tout mariage forcé. En résulte un disque étrange, traversé par la thématique duale des voyages en mer et des femmes (tous les textes de Sinfield tournent autour de ces deux axes, suite à un séjour aux Baléares au son des disques de Miles Davis) tout en se voyant illustré par la nébuleuse Trifide dans la constellation du Sagittaire (quel rapport ? Aucun !), avec deux faces radicalement opposées, l’une jazzy, sombre et tourmentée, l’autre plus “crimsonnienne” si l’on peut dire, plus frippienne en tout cas, plus lumineuse, à cheval entre rock et musique classique, qui dresse une ambiance apaisée transpercée de saillies instrumentales racées. Et ce qui devait arriver arriva : à peine Islands sur les étals des disquaires, Robert Fripp éjecte Peter Sinfield, statuant sur des différends artistiques irréconciliables entre les deux hommes. Evénement qui a le don d’irriter au plus au point les trois autres instrumentistes, déjà passablement échaudés par les délires orchestraux du guitariste qu’ils qualifient, ouvrez les guillemets, de “airy fairy shit”. Ambiance. Ainsi explose définitivement la première mouture de King Crimson qui ne se reforme que sporadiquement et à contrecœur courant 1972 pour honorer des contraintes contractuelles liées à une tournée sur le sol américain.
“Formentera Lady” débute dans le dépouillement et l’austérité, avec un sombre violoncelle qui égrène ses coups d’archets avant qu’une gracile flûte traversière ne vienne survoler un piano cristallin. Schizophrène déjà, le titre développe une mélodie vocale fragile que peine à transcender la voix assez quelconque de Bozz Burrell, au rythme d’un petit gimmick de basse qui donne le rythme à un refrain bucolique naïf. Pour autant le titre se révèle très intéressant par sa diversité, son calme, ses sombres tourments emportés par un saxophone de plus en plus malaisant au fil des quelques dix minutes que dure la musique, secondé dans ses ultimes retranchements par la troublante voix spectrale de la soprano Paulina Lucas. Tour de maître : le thème de cuivres qui achève “Formentera Lady” met sur orbite le bouillonnant et jazzy “Sailor’s Tale”, œuvre instrumentale crimsonnienne aussi décousue que saisissante, avec sa batterie qui frappe la samba au son de cuivres conquérants, avant que la tension ne retombe brutalement et qu’apparaisse (enfin !) la guitare électrique de Robert Fripp qui se livre à un solo particulièrement travaillé inspiré par ses exercices au banjo, un modèle de rythmique, de modulations entre harmonies et dissonances. Lorsque le thème principal revient en fin de titre, le chaos règne en maître, le mellotron s’est emparé de la mélodie, l’ambiance devient glauco-apocalyptique, les percussions crépitent en tous sens, vrillées dans leurs derniers retranchements par une six cordes qui assoit sa domination sans partage. Après, pourquoi une pause quasi-silencieuse de près d’une minute ? Mystère. D’autant que le début de “The Letters” se montre bien tristounet, bien quelconque également, la faute là encore à une interprétation vocale qui manque cruellement de relief sur une mélodie piquée au “Why Don’t You Just Drop In” de l’ancêtre Giles, Giles and Fripp. Le titre ne décolle véritablement que lorsqu’une bande de saxophones et de bassons débonnaires entre en jeu, bien vite asservis par la cruelle guitare du maître à la manœuvre. Point fort malheureusement bien bref puisque le reste du morceau aligne un long solo de saxo de plus en plus dérangé et pervers pour finir sur une partie chantée entre ire surjouée et complainte à peine murmurée de la part de Burrell. Un titre bizarre, bizarrement imaginé et bizarrement fagoté, sans queue ni tête, presque une improvisation absconse couchée sur bande.
Changement complet d’ambiance sur la face B qui s’ouvre avec “Ladies of the Road”, composée par Sinfield comme une “chanson de groupies” selon ses dires, sorte d’hommage aux filles qui se pâmaient dans les bras - et dans les lits - des musiciens en tournée. Ici c’est une sorte de blues rock placide survolé d’une alternance soliste entre saxophone et guitare (une contribution là encore assez remarquable de la part de Fripp), avec un Bozz Burrell nettement plus concerné, pugnace, revêche et investi : du très bon. Surprise quand débute “Prelude: Song of the Gulls” : il s’agit d’un pur morceau de musique classique au thème porté par un hautbois, tout en cordes soyeuses et pizzicati rêveurs. On s’éloigne totalement du rock mais que c’est touchant. Pour l’anecdote, c’est Robert Fripp lui-même qui en est l’auteur, de la mélodie jusqu’aux arrangements orchestraux. Concluant Islands, “Islands” (!) poursuit dans une veine classique belle et sereine, chant nacré, piano d’une délicatesse rare, écrin de trompettes, mellotron grave en totale retenue, hautbois céleste, guitare d’une grande discrétion, batterie d’abord réduite à un délicat soutien de cymbales. Le titre, tout au long de ses quelques dix minutes, développe un très lent crescendo - un modèle du genre, d’ailleurs - au gré d’une trompette de plus en plus aventureuse, aidée par un mellotron qui finit enfin par sortir de ses gonds... toutes proportions gardées, bien sûr. C’est à la fois simple et terriblement bien construit. A signaler sur certaines éditions vinyles une bizarrerie, sorte de piste cachée involontaire sous la forme d’une petite discussion studio entre les membres du groupe ponctuée d’un accordage de violons, avec des sautes de son assez malvenues. Autant s’en passer.
Il y a donc à boire et à manger dans cet Islands loin d’être aussi mauvais qu’on voudrait nous le faire croire. Original, radical, éclaté, tantôt dérangé et diablement tourmenté, tantôt baigné d’une sérénité et d’une grâce voluptueuses, contenant des titres incroyables (“Sailor’s Tale”, “Islands”), ce quatrième album de King Crimson, malgré de nombreux griefs au premier rang desquels un chant vraiment peu mémorable, possède un côté attachant sensiblement moins présent sur ses trois grands frères en dépit d’une certaine perfection formelle. Si In The Court Of The Crimson King et Lizard notamment (In The Wake Of Poseidon s’avérant, pour l’auteur de ces lignes, nettement moins remarquable) impressionnent par leur matière tout autant que par leur apparence assez révolutionnaire, Islands, lui, séduit dans ses aspérités et ses imperfections, parfait miroir des tensions et des dissensions qui couvaient à l’époque dans la formation. Un peu comme Red sublimera la colère et le désarroi d’un groupe au bord de l'abîme, Islands reflète, par certains côtés, bien plus d’humanité que nombre d’albums de l’époque et de maintenant, et c’est ce qui lui confère tout son charme. À charge pour vous de les découvrir, si ce n’est déjà fait.