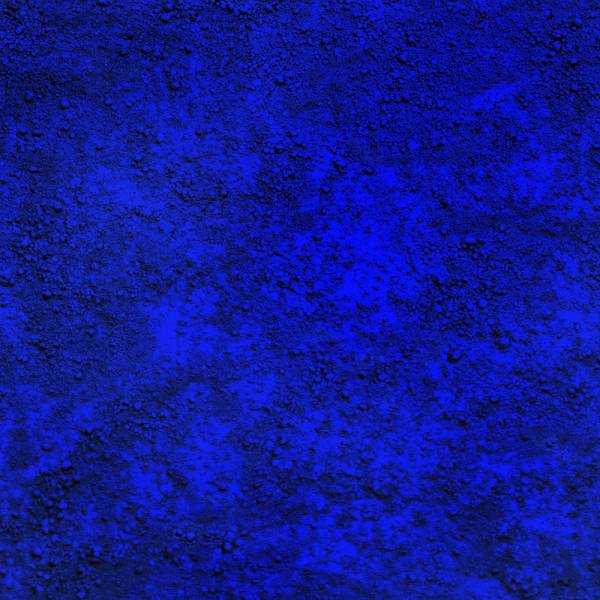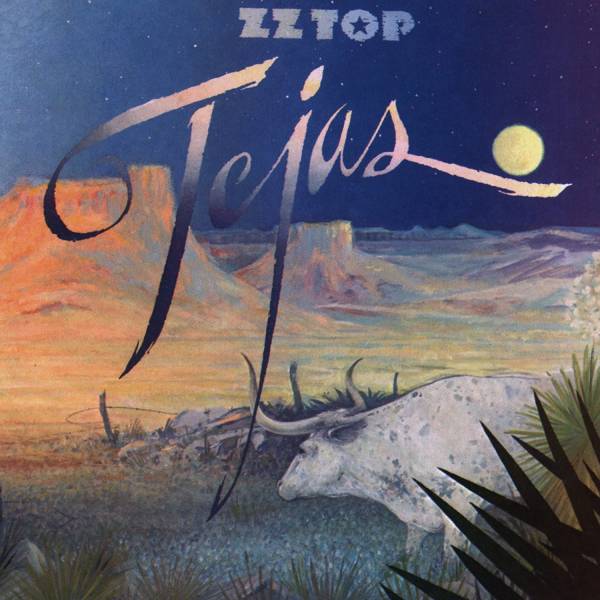Avant de m’atteler pour de bon à cette chronique qui me fait de l’œil depuis la sortie de ce
Lazaretto, nouvel album solo de
Jack White (qu’on ne présente plus), de nombreuses questions ont longtemps trotté dans mon esprit déjà suffisamment tourmenté sur la façon d’aborder le tout. En effet, mon admiration pour John Anthony Gillis n’est un secret pour personne et remonte à mes premiers émois adolescents, lorsque je découvris que l’on pouvait porter un tee-shirt rouge et un pantalon blanc (ou l’inverse) sans être ringard, qu’il était possible de martyriser sa guitare de la même couleur de riffs tranchants comme des lames de rasoir sans se faire engueuler par la voisine du 4ème et se passer de bassiste tout en se payant le luxe de jouer avec un batteur à la précision rythmique aussi aléatoire que la gestion des comptes de l’UMP. Aujourd’hui,
Jack White a troqué son ensemble vif pour un bleu plus sombre, sa colère s’est assagie au profit d’envolées country comme en témoigne le précédent opus
Blunderbuss, tout en construisant un véritable bastion autour de son label, Third Man Records, au slogan évocateur : "
Your Turntable's Not Dead" (votre platine n’est pas morte). Donc acte.
En effet, depuis sa création, non content de sortir des albums en pagaille sous différentes identités (
The Raconteurs avec son pote Brendan Benson,
The Dead Weather avec sa copine Alison Mosshart, moitié agitée des
Kills) tout en produisant une pagaille d’artistes,
Jack White se bat pour la survie du vinyle comme ce garçon romantique qui souhaiterait encore emmener sa petite amie sur les Bateaux Parisiens plutôt que d’aller boire au dernier bar à la mode sur les quais de Seine. Ce
Lazaretto n’échappe pas à la règle : dans son édition vinyle, on trouve à la fois une face brillante et une face mate, un hologramme en forme d’ange (!) qui apparaît lorsque l’on écoute le tout sur la platine, deux introductions différentes pour une seule chanson, bref, tout un ensemble de petits détails qui ferait presque passer la musique au second plan, ce que ne manqueront pas de faire remarquer les petits malins qui commenceraient à se lasser du blues électrique aux relents de country troussé par
Jack White depuis une quinzaine d’années. Et cela serait bien dommage, finalement.
Il est rare que, lorsque nous nous rendons au théâtre pour assister à une représentation d’Hamlet, nous tombions sur une version revisitée du Malade Imaginaire, Shakespeare et Molière se tirant suffisamment la bourre sur la question de la langue du rock chanté dans nos contrées. Ainsi, il en va de même pour ce
Lazaretto, voguant entre rock couillu et légèreté mélodique saupoudrée de violons et de guitare slide. Quelques nouveautés se sont tout de même glissées ici ou là, afin d’éviter la sensation de devancer les dialogues de la pièce, à commencer par ce "High Ball Stepper", premier extrait de l’album et instrumental ravageur, sombre et totalement barré, sous une forme très rarement utilisée par
Jack White ("3 Birds" sur le premier
Dead Weather étant l’exception qui confirme la règle) ; "That Black Bat Licorice", avec son refrain imparable et son irrésistible gimmick de guitare; la chanson-titre également, blues au riff solide, phrasé hip-hop et changement de rythme étourdissant. Mais mis à part ces quelques menues innovations, et malgré un son plus lourd, nous avons toujours droit à cette habituelle recette de blues nashvillien accompagné de sa salade de country. Alors, pourquoi tombe-t on encore dans le panneau ?
La réponse est simple : parce que (putain !) c’est BON. Alors que les
Black Keys se perdent dans une pop psychédélique boursouflée, à l’heure où l’on se coltine la dernière soupe FM de
Kasabian et où l’on cherche ce qu’il reste de rock’n’roll en
Linkin Park,
Jack White nous prouve que l’on peut faire du rock de façon organique sans se renouveler en grandes pompes à chaque nouvel album ; que lorsque de tels changements sont effectués, c’est toujours de façon innovante et subtile (en témoignent les textes du disque , sorte de conversation entre Jack aujourd’hui et Jack à 19 ans), pas forcément immédiate mais tellement jubilatoire ("Would You Fight For My Love", sommet de l’album et peut-être l’un des meilleurs titres écrits par White depuis longtemps) ; que malgré quelques longueurs trop prévisibles ("Just One Drink", "Entitlement") il est difficile de ne pas tomber sous le charme des envolées mélodiques ("Alone In My Home", "Temporary Ground") et l’énergie primaire du blues façon Detroit ("Three Women"). Et puis comment ne pas être conquis par le jeu de guitare de monsieur White, fuzz bourdonnante et Whammy crispante, toujours tranchant mais plus mis au service d’une batterie ingénieuse, de claviers détonants, de piano entrainant et d’une atmosphère de Stensons battant la plaine, de bateaux à aube et de néons lumineux ringards. Et puis cette voix toujours aussi indéfinissable, pas totalement juste mais si particulière… Sérieusement, tout ce cocktail, ça ne vous donne pas envie de bander?
Jack White a t il finalement encore quelque chose à prouver? D’autres diront à l’écoute de
Lazaretto que ce garçon à du mal à se réinventer complètement, à surprendre son auditoire pourtant déjà conquis, et ils n’auront pas forcément tort. Mais lorsque l’ensemble est si bien exécuté, avec autant de maitrise, d’ingéniosité et de talent, à quoi bon se faire chier à tenter autre chose ? Devant la facilité de cet argument, vous me permettrez d’en avancer un dernier : si vous êtes de l’avis contraire au mien, dites vous simplement que ce disque n’est qu’un prétexte pour
Jack White afin de remonter sur scène. Et aux vues du dernier passage du garçon à l’Olympia, il est difficile d’y trouver quelque chose à redire quand à la qualité des concerts.
Jack is fucking back.