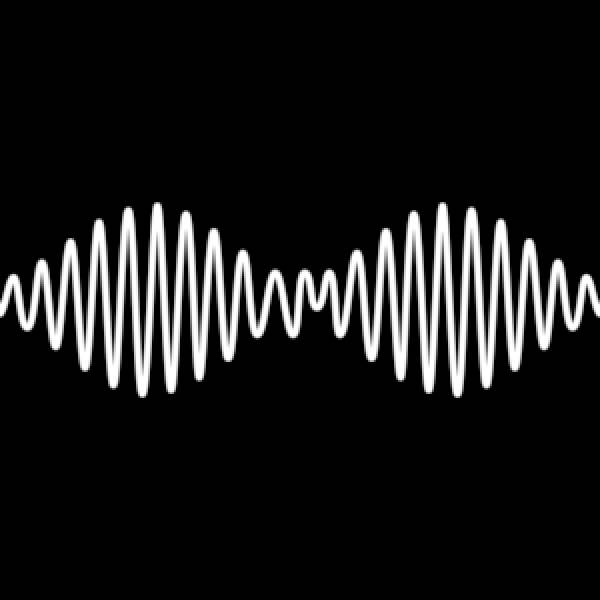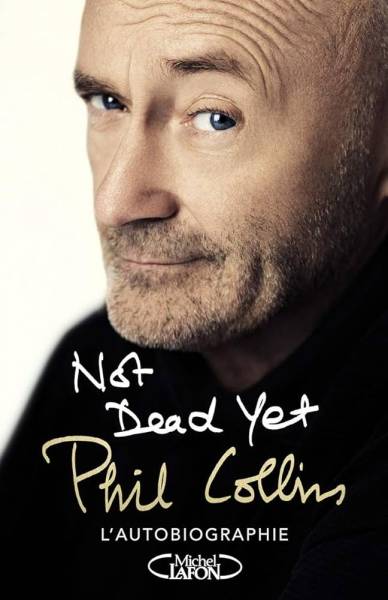Arctic Monkeys
Tranquility Base Hotel and Casino
Produit par Alex Turner, James Ford
1- Star Treatment / 2- One Point Perspective / 3- American Sports / 4- Tranquility Base Hotel & Casino / 5- Golden Trunks / 6- Four Out of Five / 7- The World's First Ever Monster Truck Front Flip / 8- Science Fiction / 9- She Looks Like Fun [Explicit] / 10- Batphone / 11- The Ultracheese


“La musique lounge (de l’anglais lounge music, littéralement « musique de salon ») désigne au départ la musique jouée dans les salons des bars d'hôtels et de casinos, mais également dans les petits cabarets et les piano-bars. C'est la version « excentrique » de la easy listening. Lancée dans les années 1950-1960, elle succède à l'ère du swing des grands orchestres. Conservant le côté doux, sirupeux, « ambiance » de la easy listening, la lounge intègre un côté expérimentation, mêlant instruments exotiques, futuristes et nouvelles technologies (stéréo notamment). Elle est un des symboles du style de vie kitsch des années 1960.” Définition Wikipedia paresseusement recopiée, et il n’y a ici rien à ajouter ni à retirer : Tranquility Base Hotel and Casino est un album de musique lounge dans tout ce que le genre a de plus caractéristique, de plus caricatural, de plus fade et de plus mièvre. Une espèce de pot pourri entre Frank Sinatra, Lana Del Rey et Serge Gainsbourg. Une enfilade de guimauves, des tartes à la crème qui se succèdent avec indolence du début à la fin, sans procurer ni frisson, ni excitation. En bref et pour faire court, un disque de musique d’ascenseur. Or c’est aussi un album des Arctic Monkeys, et ça pose quand-même problème.
Ça pose problème, parce qu’en gros tout le monde voudrait nous faire croire que hé bé non, en fait, Tranquility Base n’est pas si mal que ça, et que mieux, c’est un bon disque, voire un grand disque. Il faut dire que les Monkeys ont parfaitement su gérer l’attente qu’ils suscitaient ainsi que la publicité entourant la naissance de leur petit dernier. Une promo mystérieuse, des annonces distillées au compte goutte, un artwork intriguant, et surtout, surtout, aucun single chargé d’appâter le chaland, stratagème tout à la fois languissant et fûté, puisque la surprise à la découverte de l’album et de son virage stylistique a été totale, un peu comme quand Radiohead a balancé de but en blanc The King of Limbs sur la toile. Personne ne s’y attendait, tout le monde a été pris de cours. Pas sûr que le résultat aurait été le même avec deux-trois singles envoyés en éclaireurs, et c’est une euphémisme. Là-dessus, une fois face à cette curieuse bête, la presse spécialisée a encensé la “prise de risque” des quatre natifs de Sheffield, leur évolution, leur maturité, on a loué les qualités d’écriture d’Alex Turner, ses textes truculents - il est vrai que sur ce plan, la galette tient ses promesses -, sa voix qui lorgne désormais vers les crooners d’antan et qu’il a belle, oui madame. Des articles se sont gargarisés de décortiquer la signification des titres de chaque chanson, tandis que d’autres nous ont ressorti la sempiternelle nécessité de ne pas jeter d’emblée le disque aux orties, de lui laisser sa chance, de l’écouter, le réécouter, encore et encore, et vous verrez, oui, vous verrez, vous finirez forcément par l’aimer. Ce d’autant qu’Arctic Monkeys est maintenant une valeur sûre de la pop music contemporaine (le rock, c’est tellement galvaudé). Un groupe bien installé, une tête d’affiche incontestable en festival. Ils ont rarement déçu, leur nom est synonyme de succès, d’intégrité artistique, de renouvellement. leur dernier opus en date, AM, était vraiment parvenu à une sorte de pinacle musical, un point de ralliement presque parfait entre mélodie, son et attitude. Les Monkeys, non seulement tout le monde les aime, mais personne ne les croit capables d’un faux-pas.
Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération quand on se frotte à ce disque, ainsi que quelques informations cruciales à bien connaître. Premier item, et Alex Turner ne s’en cache d’ailleurs même plus en interview, Tranquility Base Hotel and Casino témoigne avant tout de son incapacité totale à composer du rock. Le lad l’affirme sans fard : avec AM, il a réalisé le disque qu’il souhaitait, et il ne se sent plus capable de l’égaler et encore moins de le surpasser. D’où blocage d’écriture. Là-dessus, il s’est vu offert un piano Steinway Vertegrand pour ses trente ans, pas plus tard qu’en 2016 donc, et le voilà qui, par le biais de cet instrument, retrouve l’inspiration… mais l’inspiration que l’on sait. Turner compose des morceaux “ambitieux” et les fait écouter début 2017 à ses trois compères. Là-dessus, Jamie Cook s’avoue certes “époustouflé” par ce virage mais conseille tout de même à son chef d’envisager un album solo avec ce nouveau matériel. Problème, Alex refuse : il veut que les singes de l'arctique s’approprient cette musique. Et on voit bien là le malaise poindre : fallait-il s’opposer au frontman ou au contraire laisser couler ? Il faut bien comprendre que les Monkeys ne sont incarnés que par Alex Turner et par lui seul. Cook et O’Malley, on les changerait poste pour poste que personne n’y verrait que du feu. Certes, Matt Helders assure une certaine qualité technique derrière ses fûts et peut prétendre à briller par lui-même, mais il n’est que le fucking drummer, n’est-il pas ? Donc en gros, les types ont le choix entre refuser et prendre le risque de saborder leur groupe, ou se plier aux désidératas de leur chef. Alex Turner veut que les Monkeys fassent de la lounge pop ? Alors va pour la lounge pop. Rétrospectivement, cependant, on sent bien que Tranquility Base Hotel and Casino aurait eut toute légitimité à devenir un album solo, justement parce qu’il tourne totalement le dos au rock - qui représente, quoi qu’on en dise, l’ADN des Arctic Monkeys - et qu’il casse tous les codes érigés jusqu’ici par Turner dans sa formation. Cette nuance est importante à expliciter et se place bien en amont de la qualité réelle et intrinsèque de l’album. À l’heure où le rock - on peut désormais l’affirmer péremptoirement et sans détour - est en train de crever la gueule ouvert à petit feu, on ne peut que constater que la plupart de ses ténors se contentent à peine de maintenir l’esquif à flot (Arcade Fire, Queens of the Stone Age, Foo Fighters, At the Drive-In, Royal Blood, Billy Corgan, Noel Gallagher, aux dernières productions poussives) tandis que Jack White s’agite dans tous les sens sur le pont principal en faisant littéralement n’importe quoi (Boarding House Reach, pathétique). Les Arctic Monkeys, eux, ont carrément quitté le navire, d’ailleurs c’est bien simple : si ce n’était en raison de leur nom et de leur discographie, ce LP6 aurait été passé sous silence sur Albumrock car il ne rentre pas DU TOUT dans la ligne éditoriale de notre site bien aimé. Donc oui, quelque part, il y a de quoi grincer des dents.
Mais ça va plus loin. Puisqu’il nous faut critiquer ce disque, on s’excusera d’abord auprès de notre lectorat de ne rien y connaître en pop lounge, comme ça c’est dit : il n’y a donc ici aucun repère comparatif pour juger de sa qualité. On évacuera ensuite les influences supposées que Turner aurait puisé chez David Bowie comme on peut le lire un peu partout, déjà parce qu’il ne s’en est pas spécialement vanté - Turner, pas Bowie, hin hin -, ensuite parce qu’elles sont loin d’être évidentes, et enfin, merde, parce qu’il y en a marre de devoir s’incliner dès que le Thin White Duke est invité dans une discussion, référence voulue insurpassable par l’intelligentsia rock déjà de son vivant mais plus encore depuis qu’il est passé l’arme à gauche. N’en déplaise aux fans, il y a des types - comme bibi - qui ne peuvent pas saquer Bowie et qui n’ont jamais éprouvé le moindre frisson en écoutant l’un de ses disques - y compris l’ultra-encensé Black Star posthume qui m’a cliniquement laissé de marbre. Donc Alex Turner chante comme Bowie - ou pas -, la belle affaire. Mais Alex Turner chante surtout comme un crooner, et mince quoi, il en vraiment fait des caisses. Entendre le garçon minauder dans des articulations empesées et précieuses, en particulier sur le morceau titre, aurait de quoi flanquer une diarrhée à n’importe quel adepte d’un régime à base de riz et de patate - sans fibres ajoutées. Ce parti-pris vocal apporte déjà un supplément de sirop de rhubarbe à un disque qui, mon dieu, n’en demandait pas tant. C’est bien simple : onze titre, un seul tempo, le moral à zéro. C’est mou, c’est lent, c’est répétitif, c’est fade. C’est chiant.
Rien qu’à l’écoute de l’entame, on hésite entre un sourire goguenard, un bâillement compulsif ou une larme d’amertume tellement “Star Treatment” ne dégage RIEN qui ne nous permette de fredonner, de taper du pied, de dodeliner de la tête, vous savez, ce genre de choses qui font qu’on aime écouter de la musique. Le reste confirme le parti-pris érigé par ce titre liminaire puisque la même recette y est grosso-modo reprise partout : un piano omniprésent, un synthé qui abuse de petites notes répétitives exaspérantes, une basse qui cachetonne avec béatitude, une guitare famélique au possible - quand elle est présente -, une batterie neurasthénique (on peine à imaginer qu’un grand gaillard comme Helders se soit compromis dans ce registre), une absence criante d’airs à chanter, des refrains qui peinent à se distinguer des couplets. “One Point Perspective” s’englue dans une mélasse chicos de piano-bar pour millionaires bourrés et déprimés - et Turner qui minaude de plus belle, rhaa -, et puis, oh, il y a une coda qui a l’air sympa là… ah ben non, c’est juste le morceau suivant, “American Sport”, qui s’enchaîne sans crier gare. Alors les minutes défilent, les bâillements également - la crampe de mâchoire n’est plus très loin -, on lève un sourcil sur un enchaînement d’accords sympa-mais-sans-plus (“Tranquility…”), on le fronce en entendant des secondes voix zarbi sur un air au ras de pâquerettes (“Golden Trunk”, paraît que c’est une allégorie de Donald Trump, le check politiquement correct a bien été coché), on rigole poliment en découvrant la valsounette de service et le nom du morceau suivant (“The World’s Ever Monster Truck Front Flip”), on se dit que “Science Fiction” aurait pu être cool avec sa petite rythmique indolente, sauf qu’il ne l’est pas, on ne se pose même pas la question avec “She Looks Like Fun” et ses atours pachydermiques parce qu’à ce stade il est vraiment difficile de rester concentré sur le disque, mais le plus dur est encore à venir, parce qu’avec le duo “Batphone” - “Ultracheese”, le groupe a pondu le pire du pire : gimmick de synthé horripilant pour l’un, slow insupportable de classicisme pour l’autre. Quand “Star Treatment” revient avec la fonction repeat all, d’une, on ne s’en rend pas compte immédiatement, de deux, on se surprend encore à essayer de comprendre comment les Arctic Monkeys ont pu se fourvoyer dans une daube pareille. Dans la critique de Suck It And See, votre serviteur avait écrit : “Pour apprécier convenablement un nouveau disque des Arctic Monkeys, il faut avoir au préalable effectué le deuil du (des) précédent(s).” Sauf que là, le deuil est impossible à faire, car on ne retrouve plus rien de ce qu’on a abandonné. Qualitativement parlant, s’entend.
Les plus malins l’auront noté, on a volontairement oublié d’aborder le cas de “Four Out Of Five”, parce que oui, quand-même, ce morceau-là vaut le coup : la ligne de basse est sympathique, il y a un soupçon d’énergie, d’émotion contenue, il y a de la mélodie, un refrain. Bien sûr, passé deux minutes, le titre s’enfonce dans une fausse redondance qui trompe son monde sur des variations hasardeuses, mais le fait est là. Tranquility Base Hotel and Casino n’est pas totalement nul : il l’est presque totalement, nuance, et on est bien loin d’un disque “quatre étoiles” (c’est la méthode Coué, mon cher Alex ?). On précisera quand même s’être vraiment forcer à écouter en boucle ce disque, plusieurs dizaines de fois, avant de rendre un verdict aussi navrant. Parce que, hé hé, les Monkeys, non seulement tout le monde les aime, mais personne ne les croit capables d’un faux-pas. Sauf que le faux-pas est arrivé, et dans son genre, il est magnifique : espérons simplement qu’il ne se reproduise pas.